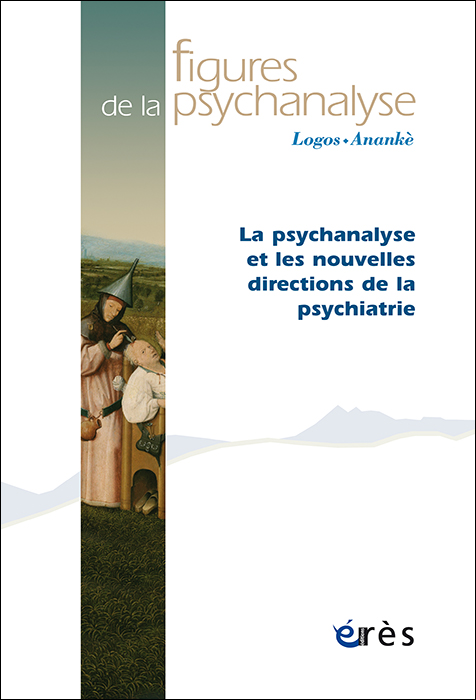Dossier : journal des psychologues n°237
Auteur(s) : Ponroy Annabelle
Présentation
En psychiatrie, pour dépasser les protocoles, les grilles d’évaluation, les méthodologies, le souffle nécessaire peut manquer. Ce souffle, c’est celui d’un travail, celui de la parole et celui d’une réflexion authentique sur la pratique. Ce travail est éprouvant, il est néanmoins vital, car il vise ce qu’il y a de plus profondément humain dans le rapport à l’autre, au centre du travail des équipes à l’hôpital.
Mots Clés
Détail de l'article
La liste est longue des catastrophes annoncées dans le monde contemporain, « postmoderne », pour reprendre une terminologie entendue. La liste est longue des inquiétudes concernant l’état de crise du champ qui est le nôtre – sorte d’aquarium de notre société, tant nous pouvons y observer en modèle réduit, c’est-à-dire en grossissant le malaise qui nous affecte –, le champ psychiatrique.
Les États généraux de la psychiatrie, en 2003, avaient très habilement décrit le malaise : manque de moyens, protocolarisation des offres de soin, psychisme confondu avec cerveau, guérison à moindre frais, réponse médicamenteuse abusive, déni de la folie au profit de politiques hygiénistes, disparition du travail institutionnel, recul inquiétant de l’approche psychanalytique, formation au personnel effectuée presque exclusivement par les laboratoires pharmaceutiques, « externement » abusif, pénurie de chercheurs en psychiatrie, empirisme ravageant des méthodologies DSM (1), ravalement du sujet…
Les États généraux, sorte de camp retranché, qui nous font espérer, le temps d’un clic de souris, que la psychiatrie pense, mais dont personne ne parle dans nos miséreux services de banlieue ou de province. Mais parlons-nous ? Ne serait-il pas plus approprié de parler d’agitation ? Nous nous agitons. Si vous êtes adeptes du footing, vous savez sans doute combien il est difficile de parler en courant, le souffle nous manque !
La dénonciation de cette agitation et de tous ses méfaits n’a-t-elle pas fait son temps ? Nous savons que la psychiatrie s’est constituée au service d’une idéologie disciplinaire (2), laquelle idéologie, profondément individualiste en tant qu’elle distribue de la case (malades mentaux, délinquants médico-légaux, toxicomanes, schizophrènes, psychopathes…), en tant qu’elle distribue de l’individu, distribue de l’étranger radical. Constituer l’autre comme étranger radical met de fait à l’abri de toute rencontre ? En distribuant de la case, à savoir de l’individu, la procédure constitue l’autre comme étranger radical, comme « tout autre » et, dans cette opération, exclut le commun qui pourrait autoriser une rencontre. Dans un tel dispositif, il n’y a pas à s’étonner ni à s’offusquer qu’une parole soit difficile ? Lorsque l’on s’adresse à un « toxicomane » en lieu et place de s’adresser à un homme, comment peut-on espérer une rencontre, un lien ?
Comment ne pas comprendre l’engouement de certains professionnels pour les méthodologies et les protocoles qui leur sont distribués ? Lorsque, avec l’autre, la langue commune est épuisée, nous n’avons pas d’autre choix que de nous précipiter sur notre dictionnaire pour tenter d’ânonner quelques mots qui n’ont aucun sens pour nous, mais qui peuvent donner l’illusion d’avoir rompu un silence assourdissant.
Passé le temps de la dénonciation, parce que nous savons que la psychiatrie participe de l’idéologie disciplinaire, nous avons à en prendre acte. Prendre acte, ça veut dire quoi ? Peut-être au moins savoir où nous avons mis les pieds ; ainsi, le plus étonnant n’est peut-être pas le recul de la psychanalyse en ces lieux, mais qu’elle y soit un jour entrée.
Et, pour ceux qui s’intéressent à l’histoire de la psychiatrie, nous savons qu’elle y est entrée dans un contexte bien particulier, soit à un moment où un certain traitement de l’autre avait fait horreur, soit à un moment où nous avons entrevu jusqu’où l’érection de l’autre en étranger radical avait pu nous mener, soit dans un temps où était mis à nu, de la manière la plus radicale qui soit, ce que peut comporter de violence notre rapport à l’autre, et où, de ce fait, nous avions à réinventer du lien, afin de nous protéger de l’horreur de ce qui avait été ainsi dévoilé.
La psychanalyse est entrée à l’hôpital parce que les médecins psychiatres ont pris peur. Mais qu’ont-ils craint, sinon leur propre violence à l’égard de l’homme fou ? Ils sont allés, pour certains, jusqu’à se poser la question de savoir s’ils n’étaient pas rien moins que des gardiens de camps (3). Tout le courant de la psychothérapie institutionnelle a vu le jour à partir de cette peur-là. La psychanalyse a alors été utilisée, et bien souvent détournée, pour réinventer un nouvel ordre social à l’intérieur de l’hôpital, un ordre social plus acceptable. Les ateliers de sociothérapie, les groupes de parole, d’art-thérapie… ont vu le jour dans ce contexte. Tous les dispositifs avec lesquels nous travaillons encore aujourd’hui sont nés pour fuir cette menace. Il est alors plus aisé de comprendre comment, soixante ans plus tard, nous en sommes arrivés à dénoncer des « externements abusifs ».
L’hôpital ne peut plus être un lieu de vie ni même un lieu d’accueil, tant il est pollué par une culpabilité impossible à apaiser, parce que, sans rien vouloir en savoir, les psychiatres ne sont toujours pas sûrs de ne pas être des gardiens de camps. Ainsi, lorsqu’un patient franchit la porte de l’hôpital, la première question qui se pose est : quand va-t-il sortir ? Et ce n’est que sous la contrainte de ses passages à l’acte répétés que nous pouvons faire accueil à l’autre et que, dans un « Il l’aura bien mérité », nous l’envoyons, la mort dans l’âme, dans un de ces pavillons de « chronique », ultime témoignage – qu’il faut à tout prix garder visible, pour ne pas nous donner la peine de l’élaborer – de ce que la psychiatrie serait parente des camps. Pavillon dans lequel des hommes et des femmes passent une vie entière parfois, mais à qui l’on refuse de nommer « lieu de vie » ces murs qui, pourtant, sont les leurs, tant l’ombre des camps plane.
Si, de sa filiation disciplinaire, la psychiatrie a toujours peiné à être un lieu de parole, aujourd’hui, parce qu’elle est hantée par une ombre qu’elle ne veut pas lâcher, elle peine de surcroît à faire asile.
Comment continuer alors à s’indigner ou à s’étonner de ce que la psychiatrie s’engouffre dans tout ce qui lui est proposé de protocoles, de méthodes, de grilles d’évaluation… dans tout ce qui lui permet de l’empêcher de penser, de l’empêcher de parler, de l’empêcher de désirer, tant elle s’asphyxie de la boue infamante dans laquelle elle pense avoir vu le jour, boue de la discipline, boue de la folie, boue des camps qui lui fait horreur, mais que, pourtant, elle ne veut pas lâcher.
Alors il n’y a pas à s’indigner. Nous l’avons vu, l’indignation ne mène pas bien loin, mais à prendre acte, c’est-à-dire à entendre, à parler. Qu’est-ce que signifie prendre la parole ? Parce qu’il est une chose à noter, si la difficulté d’entendre la parole d’un patient dans ces lieux n’est plus à démontrer – en tout cas, cette question a déjà été largement commentée –, la difficulté de parole du personnel soignant est quant à elle sans doute moins travaillée, et ce, à tous les échelons de la hiérarchie. Ajoutons que cette difficulté n’est en aucun cas contenue dans un rapport de pouvoir infirmiers/ médecins, par exemple, mais dans un souci, disons « névrotique », de ne pas s’engager, de ne pas se risquer, et cela, que l’on soit médecin ou infirmier, mais aussi psychologue ou psychomotricien.
De s’être saisi avec autant de ferveur des protocoles, des grilles d’évaluation, des méthodologies DSM… les professionnels de la psychiatrie se sont eux-mêmes coupés de leur propre parole. L’économie du lien ainsi réalisée, ces professionnels la payent de leur propre asphyxie. Prisonniers de méthodologies rigides, toute confiance dans leur parole s’est dissoute.
C’est dans ce contexte que nous avons accepté la proposition qui nous a été faite de prendre la parole lors de la « journée qualité », organisée au sein de l’hôpital, et dont le thème portait sur « l’évaluation des pratiques professionnelles ». Si l’organisation de telles journées s’explique dans la volonté d’une administration de présenter sous son meilleur jour la mise en place d’une évaluation que les professionnels ne voient pas d’un très bon œil, il n’en reste pas moins que, parmi les organisateurs, quelqu’un a eu l’idée de solliciter une réflexion concernant cette évaluation. C’est tout à fait ce que nous appelons « prendre la parole ». Cette personne, dans son souci de proposer un autre discours, s’est adressée à nous. Son acte est un équivalent de parole. Il nous restait la délicate entreprise d’intervenir, de dire, sans nous engouffrer dans la contestation, parce que le discours contre est toujours un discours qui parle la langue de l’autre.
Notre intervention a donc développé les points suivants :
◆ Prendre acte que nous avions entendu des peurs de la part des professionnels face à ce projet d’évaluation des pratiques professionnelles.
◆ Poser la question de la clinique : qu’est-ce qu’un clinicien ? Un clinicien, c’est quelqu’un qui est dans le lien.
◆ Peut-on évaluer du lien ?
◆ Où en sommes-nous de notre désir de travailler avec les fous ?
◆ Peut-on définir du soin dans un protocole en ignorant ce qu’il en est de l’affect, en ignorant ce qu’il en est de notre lien, non pas aux patients, mais à ce patient-là en particulier ?
◆ Peut-on envisager la clinique, sans envisager la question du désir du clinicien ? Désir qui ne peut sans doute pas s’évaluer, mais qui peut se travailler. Parce que les demandes que nous adressent les patients ne se referment sur aucun objet, nous avons à chaque fois à travailler la rencontre avec un patient, afin de pouvoir entendre ce qu’il demande au-delà de ce qui se formule.
◆ Comment entendre que nos patients demandent autre chose que ce qu’ils réclament ?
◆ L’Homme est-il un être de besoin ?
◆ Comment entendre les demandes qui nous sont adressées si nous ne pouvons engager notre désir auprès de ceux que nous rencontrons dans notre travail de clinicien ?
◆ Comment prendre en compte cette question indépassable qui est que nous sommes partie prenante dans les soins que nous donnons aux patients ? Nous n’avons pas à en avoir peur, mais nous devons nous donner le temps de nous écouter, de penser, de ressentir, d’être troublés, agacés.
l Comment ne pas oublier que nous sommes le dernier refuge ? L’hôpital psychiatrique est le dernier refuge que nos institutions proposent à ceux pour qui la souffrance voisine avec l’intolérable… intolérable que nous affrontons chaque jour. Comment pouvons-nous avoir la vanité de penser en sortir indemnes ?
◆ Comment continuer à penser que lorsque nous parlons d’un patient, c’est seulement de lui dont nous parlons ? N’est-ce pas aussi de nous dont nous parlons à ce moment-là ?
◆ Pouvons-nous nous contenter de penser que tel patient va mal parce qu’il est fou ? La folie doit-elle être une raison suffisante pour nous empêcher de penser ?
◆ N’avons-nous pas à nous mettre au travail dans une réflexion sur nos pratiques ? Une réflexion qui ne vise pas la bonne manière de faire, qui ne vise pas la performance, mais qui n’ignore pas à quel point nous sommes aussi fragiles.
◆ N’est-il pas humainement impensable de se dégager des liens transférentiels qui nous unissent aux patients que nous accueillons ? N’est-il pas vital pour notre travail et pour le respect de ceux que nous accueillons de prendre le temps d’un échange autour de nos pratiques ? Ces échanges ne visent pas l’élaboration d’une technique, mais la mise au travail d’un lien où la critique n’est pas ravalée au rang de l’erreur. Lorsqu’elle se soumet à l’autre, la clinique ne rejoint jamais ni l’erreur ni la vérité.
◆ Ce travail de la parole est un travail qui n’a pas de fin. Continuer à échanger, n’est-ce pas le minimum de respect que nous devons à ceux qui s’adressent à nous ? N’est-ce pas une manière de dire qu’on ne les prend pas pour des imbéciles ? Une manière de dire qu’on ne travaille pas avec un homme en le prenant pour un mort ?
◆ Cette démarche appelle-t-elle à évaluation ? Au mieux – mais c’est déjà beaucoup –, n’appelle-t-elle pas à un désir ? Désir de travail, désir de s’engager, d’y mettre de sa peau… N’est-ce pas sur ce désir-là que, dans leurs incessantes demandes, nos patients nous interrogent ? N’est-ce pas la seule chose que nous ayons à donner ?
◆ Et si ce travail appelle à un désir – comme chacun sait – tout en ne voulant rien en savoir, nous ne pouvons pas désirer à la place de l’autre.
Les effets produits par ce discours nous ont conduits à nous poser la question de savoir à quoi nous avions touché. Il y eut d’abord un silence incroyable pendant toute la durée de notre intervention, silence qui contrastait avec l’ambiance plus agitée du début de matinée lors de la présentation de différents protocoles et méthodologies de soin.
La très grande concentration de la salle était tout à fait perceptible. Mais, surtout, quelle ne fut pas notre surprise de nous apercevoir que nombre de personnes pleuraient. Pourquoi ces personnes pleuraient-elles ? Pourquoi cette concentration incroyable ?
Essayons une interprétation : nous avions proposé un discours vivant qui légitimait enfin l’affect. Nous ne sommes pas sans savoir que le travail des équipes en psychiatrie est un travail affectivement éprouvant. Épreuve que les nombreux protocoles, les nombreuses méthodologies ne proposent pas d’entendre. Et non seulement ces protocoles ne peuvent être que sourds à la souffrance d’une équipe, d’un soignant, mais leur méthodologie condamne l’autre à refouler cette souffrance. D’une certaine manière, ces méthodologies invitent les soignants à se taire. Ces protocoles portent en eux une injonction à se taire. À se taire non seulement sur sa souffrance, mais aussi sur son désir. Ce ne sont rien moins que des discours sans parole.
Les questions que ces personnels se posent et que les protocoles les plus sophistiqués peinent à étouffer tout à fait – car, quand même, c’est du Freud de la première heure de savoir que l’on n’est jamais quitte de ce que nous refoulons – n’ont plus qu’à se transformer en angoisse, en peur et en violence, faute d’atteindre à la dignité de pouvoir être dite. Cette amertume ne conduit-elle pas alors au repli sur un objet réel ? Remplir des fiches informatiques, ouvrir des portes, passer des commandes de repas, suivre à la lettre des protocoles, distribuer des médicaments… et se plaindre, se plaindre de tous ces petits objets que l’on ne peut plus lâcher sans angoisser, mais qui, chaque jour, étouffent davantage de ne plus risquer son désir. Désir d’écouter, de parler avec ces patients, hommes et femmes, nourris, lavés, observés, mais que l’on ne peut plus entendre, tant l’illusion des méthodologies savantes a réduit à la peur, dans sa déconfiture, toute une génération de personnels en psychiatrie.
L’engouement qui nous a toujours semblé un peu curieux de ces professionnels pour tous ces protocoles ne tient-il pas aussi à ce qui ravit toujours le névrosé, soit la possibilité de s’engouffrer dans une stratégie d’évitement par rapport au désir ?
N’est-ce pas de cette asphyxie enfin dévoilée dont témoignaient les larmes et l’émotion de toute une assemblé de soignants dont le désir, l’affect et la souffrance étaient enfin légitimés. Un discours vivant avait enfin offert à l’autre l’incroyable opportunité de sortir de son mortel ennui.
Ainsi, nous ne devons pas négliger les opportunités qui nous sont faites dans nos institutions de prendre la parole, si cette possibilité de parole est trop rare, notre expérience témoigne qu’elle est encore possible. Cette intervention dans cette possibilité dévoilée a donné envie à tout un collège de psychologues de proposer un colloque au sein de l’institution sur le thème : « Clinique du sujet en psychiatrie ».
Parce que, lorsque nous posons un acte, nous ne pouvons jamais prévoir – même dans les situations les plus fermées – quel destin lui sera réservé, n’avons-nous pas le devoir de ne pas céder ? ■
Notes
1. Ponroy A., 2004, « DSM et 6,4,2. À propos de… “Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux” de l’American Psychiatric Association », Évolution psychiatrique, 69 : 714-716.
2. Foucault M., 2003, Le Pouvoir psychiatrique, Paris, Seuil/Gallimard.
3. Fouquet F., Murard L., 1975, Histoire de la psychiatrie de secteur, Recherches, Paris.