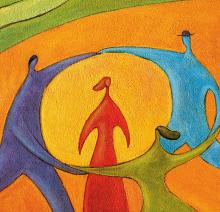Pour effectuer une recherche précise veuillez utiliser le moteur de recherche détaillé.
Corps, symbolisation et hyperactivité
Depuis plusieurs décennies, tout s’accélère… tout va très vite… Trop vite ? La clinique quotidienne témoigne d’une augmentation très sensible des troubles dits « narcissiques », au détriment d’une symptomatologie névrotique plus classique. Une sorte de tendance générale pousse l’individu à se détourner du monde extérieur pour entrer dans la toute-puissance et l’illusion narcissique.
Schizophrénie et remédiation cognitive
Lorsqu’il s’agit de nouveauté, les principes généraux reposent souvent sur des connaissances anciennes enfouies et parfois écartées. C’est le cas des pathologies aujourd’hui englobées dans la sphère de la schizophrénie. En effet, la description princeps du trouble insistait d’emblée sur l’importance des troubles précoces de l’attention (Kraepelin, 1899), la spécificité de certains aspects de la cognition comme la désorganisation temporo-spatiale (Bleuler, 1911) ou la rigidité de la pensée (Grant et Berg, 1948). Aujourd’hui, des modèles neuropsychologiques offrent un cadre à ces troubles antérieurement décrits.
Les risques psychosociaux : de la prévention au soutien psychologique
Le monde du travail, depuis ces vingt dernières années, a connu des reconfigurations importantes tant dans sa forme que dans ses modalités et ses conditions d’exercice. Le challenge, la compétitivité, le rendement, l’efficacité, le retour sur investissement… telles sont désormais les expressions courantes de nos sociétés postmodernes, emportées par le diktat de l’économie.
Patient et famille en psychiatrie. L’approche systémique
L’approche systémique propose un changement de paradigme : le passage d’une lecture du symptôme en termes familiaux plutôt qu’individuels. Pour autant, les questions de l’individu, de sa structure de personnalité, de sa maladie, n’y sont pas niées, encore moins négligées (Selvini, 2010).
De la précarité à l’exclusion : quel soutien psychologique ?
Comme en témoigne l’adoption du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en janvier dernier, le sort des personnes que les économies modernes jettent à la rue – hors de leur domicile et, parfois même, hors de leurs frontières – est une préoccupation majeure du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
L’obésité, une expression corporelle ?
La France compte des millions de personnes en situation d’obésité. Et les enfants tout autant que les adultes sont concernés. L’Oms parle d’« épidémie mondiale ». Pourtant, rien ou presque ne figure dans le cursus de formation des psychologues. Ce paradoxe illustrerait-il le contre-transfert négatif à l’égard de cette population qui règne dans tous les secteurs de la société, y compris dans nos rangs ? Dans le cadre de ce dossier, nous proposons une approche peu attendue en ce domaine pour mieux comprendre la personne en obésité.
Les psychologues face à la psychothérapie
Définie comme « un processus intentionnel et documenté par lequel sont appliquées des méthodes cliniques et des postures interpersonnelles dérivées de principes psychologiques scientifiquement avérés, dans l’objectif d’assister des personnes, de modifier leurs comportements, cognitions, émotions et-ou autres caractéristiques personnelles dans le sens jugé désirable par ces derniers » (APA, 2013), la psychothérapie apparaît comme une pratique diversifiée et complexe, en perpétuelle mutation, attentivement scrutée par ses usagers et prescripteurs, régulièrement interrogée par la recherche scientifique. Pratique aux multiples facettes, elle impacte indéniablement ceux qui l’exercent ou ceux qui s’y engagent.
La périnatalité à la croisée des pratiques
La psychologie clinique périnatale se donne deux objectifs indissociables : • accueillir les dysharmonies relationnelles parents-embryon / fœtus / bébé, ainsi que les souffrances familiales ; • engager une réflexion clinique et éthique sur les conditions d’existence d’une fonction soignante bientraitante. Dans ce contexte, elle occupe aujourd’hui une place privilégiée pour relever les défis d’une clinique contemporaine riche de sa diversité.
La virilité est-elle en crise ?
Depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, la virilité n’a jamais cessé d’être explorée par la philosophie et les sciences humaines et sociales*. D’abord associée aux notions de force, de domination, de courage, elle a progressivement intégré, dans son champ sémantique, des vertus psychologiques ou morales. Rapprochée souvent de celle de la masculinité – ensemble de traits attribués aux personnes de sexe masculin –, elle s’en distingue, cependant, par une plus grande visibilité et superlativité.
L’homme mesurable : Évaluer ou dévaluer les pratiques ?
Aujourd’hui, les pratiques évaluatives se sont transformées en un véritable raz-de-marée. Envahissant tous les domaines du secteur marchand, bien sûr, mais aussi la santé, la recherche, la justice et bien d’autres.