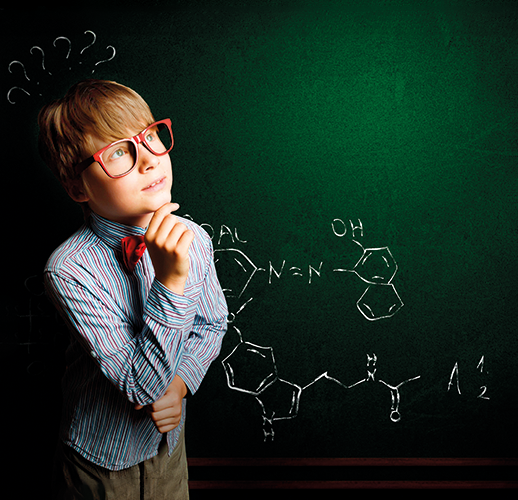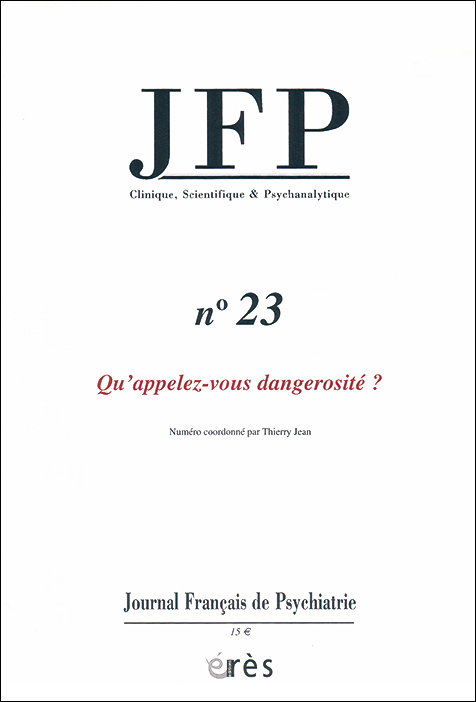Dossier : journal des psychologues n°230
Auteur(s) : Viaux Jean-Luc
Présentation
En psychologie légale, le psychologue est amené à pratiquer, à la demande d’un tiers, des investigations sur un large public, ce qui rend l’examen psychologique peu homogène d’un praticien à un autre. L’homogénéité et la cohérence des pratiques de l’examen psychologique dans un tel contexte sont-elles possibles ? Et quelle est alors la tâche la plus urgente pour le psychologue légiste ?
Mots Clés
Détail de l'article
En psychologie légale, le psychologue est amené à pratiquer des investigations sur un public varié, dans un but qui est fixé par un magistrat (procureur, juge d’instruction, juge des enfants, juge de la famille…). S’il reste libre de sa démarche et de la construction de son examen, il n’en est pas moins tenu par cet objectif, c’est-à-dire les questions posées auxquelles la conclusion de son rapport doit apporter réponse. Compte tenu des conditions de travail des experts, le fait que ces missions soient aussi vastes qu’imprécisément formulées ne facilite pas les choix techniques à opérer dans des examens.
Exemple : « Dire si cette personne présente des troubles ou déficiences susceptibles d’influencer son comportement, faire connaître les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances et les conditions qui ont influé sur la formation de celle-ci, les mobiles intellectuels et les motivations affectives qui inspirent habituellement sa conduite. »
Cette question pourrait supposer plusieurs semaines d’investigations (observations, tests psychométriques et projectifs, plusieurs entretiens anamnestiques), documentées par les témoignages des proches pour la reconstitution de son passé affectif et scolaire. Mais est-ce de cela qu’il s’agit ? On se prend aussi à rêver devant des formulations telles que : « Déterminer l’intelligence, l’habileté manuelle, l’attention », « Indiquer si la personne est susceptible de se réadapter ou de résorber la pathologie dont elle souffre et quels moyens il conviendrait de mettre en œuvre pour favoriser sa réadaptation » : l’habileté manuelle de l’agresseur sexuel… la prédiction d’une « réadaptation » et de ses moyens avant l’établissement d’une culpabilité et de connaître les décisions judiciaires (prison, sursis, TIG, surveillance électronique, acquittement)… On pourrait s’interroger tout autant sur les missions concernant des victimes : « Notamment indiquer quel est son niveau d’information en matière sexuelle » ou bien : « Quelles sont les références en matière de “niveau d’information sexuelle” ? » En quoi cela concerne la clinique psychologique plutôt que la morale (et laquelle) ?
Construire un examen psychologique rationnel et moderne à partir d’aussi vieilles questions (1), aussi mal formulées, relève de la quadrature du cercle : soit le psychologue, imperméable au questionnement de la justice et à la particularité du dossier, ne fait que ce qu’il entend et développe son propre standard ; soit il « s’adapte » à ce qu’il sait des attentes d’un magistrat pour lequel il travaille régulièrement, sans trop tenir compte du rituel de questions standard ; soit, encore, il répond du mieux possible aux questions en signalant les questions auxquelles il n’y a pas de réponses en termes psychologiques. à lire nombre de dossiers, chacun semble faire avec, et comme il l’entend. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas homogénéité des pratiques et que la justice s’en accommode.
C’est pour cela qu’évoquer des nouveautés en cette matière est une gageure, puisque les préoccupations de la justice n’ont guère changé et que la formation en matière d’examen psychologique spécialisé à telle ou telle pratique n’est sans doute pas le souci central des diverses réformes du cursus.
Tout au plus peut-on faire quelques réflexions.
La pratique expertale s’inscrit dans une culture clinique et judiciaire
Dans le système américain, les experts (forensic psychologist) disposent de référentiels de formations et d’un diplôme certifiant leur qualification. Le système juridique et la place de l’expert sont assez peu comparables au nôtre, puisque l’expertise peut servir de preuve et que chaque partie dispose, lors du procès, de ses propres experts. Mais, du fait même de cette place particulière, le psychologue est tenu à une forte démonstration de ce qu’il énonce, d’où un recours indispensable à des outils de type tests, dont les qualités psychométriques peuvent être discutées à l’audience. Interrogés sur les tests psychologiques qui leur semblent pertinents pour diverses activités, des experts diplômés privilégient ainsi les questionnaires, inventaires de personnalité ou échelles cliniques (MMPI 2, PCL- R (2), notamment) et considèrent généralement les dessins et tests projectifs comme non pertinents dans toutes les situations (Lallys S., 2003 (3). Les mêmes réserves sur la pertinence des tests cognitifs aussi bien que projectifs ont été émises depuis longtemps en matière de victimisation (Waterman et Lusk, 1993 (4).
Nous ne pouvons raisonner sur le même modèle pour toutes sortes de raisons. L’une de ces raisons est une « culture » clinique, assez répandue, bien au-delà de la profession de psychologue et qui, dans une tradition bien française, privilégie la dialectique et le discours aux arguments de type linéaire. La raison la moins honorable est que, dans les conditions de temps imparties, de rémunération, et vu la sordidité bruyante de nombre de lieux où se pratique l’expertise (dans les prisons notamment), réaliser un examen psychologique conforme à la théorie est un exploit (5). Il faut, par conséquent, s’adapter et faire « avec » : avec le peu de moyens mis à disposition, avec des demandes qui sont souvent inadaptées à la clinique que peut développer l’expert psychologue, avec des outils qui n’ont que peu de spécificité.
Si, depuis une loi de 2004 (2004-130, 11 février 2004), les experts ont une obligation de formation pour figurer sur une liste de cour d’appel, la question du référentiel de formation par profession, permettant de se dire « compétent », n’est en rien abordée : la formation qui permettra de justifier de sa candidature est en fait purement juridique.
Fonder l’examen sur une démarche théorique explicite
La tâche la plus urgente pour le psychologue légiste (6) consiste à cerner de quoi il est question, au-delà du simple examen de personnalité. Quand on travaille sous mandat judiciaire, c’est que l’on est dans un questionnement qui n’est pas le nôtre et qu’il faut donc respecter, tout en ramenant sur la scène sociale et judicaire le sujet, ce qui est le fondement même de la démarche clinique pour les cliniciens. Encore faut-il souligner que cette démarche ne peut rester la seule à concourir à la connaissance des personnes et à répondre aux questions de la justice. La perpétuelle question de la « crédibilité » des victimes ne relève en rien d’une démarche clinique, mais d’une démarche de validation du témoignage qui a été travaillée, le plus souvent, en psychologie sociale.
Ce qui serait nouveau et pertinent serait que chaque fois que la question se pose ou est posée chaque psychologue requis fasse la distinction – ne serait-ce que par pédagogie – entre ce qui appartient à divers champs de recherches et de théories et recadre clairement le champ du possible et donc le pourquoi de sa démarche.
C’est, en effet, sur le plan théorique que de nombreuses questions se posent : qu’est-ce qu’un examen « de personnalité », si ce n’est une investigation qui se réfère à une théorie de la personnalité… Qu’est ce qu’un « trouble de la personnalité » ou une « structure » par rapport à une pathologie ? Cette question n’a rien de faussement naïf, puisque, souvent, l’expertise psychologique est parallèle à une expertise psychiatrique et que, selon l’heuristique de référence, on peut employer les mêmes mots (névroses, états limites…) avec des acceptions totalement différentes, auxquelles le profane ne comprendra rien (7).
Il est tout aussi ridicule de prétendre que recourir au DSM-IV ou au CIMX relève d’une démarche athéorique, quand on lit tant de réfutations argumentées de certaines descriptions contenues dans ces manuels diagnostiques, que de prétendre qu’il y a « une » théorie psychodynamique et « une » démarche clinique que l’on oppose à toutes les autres théories.
Les questions que la justice se pose ne sont plus seulement de savoir quelle est la personnalité du sujet et son « éducabilité », mais de prédire son comportement – dans l’environnement sécuritaire de notre société – et de lui faire prescrire, si besoin, une thérapie (qu’il soit auteur, victime, parent défaillant ou enfant maltraité, etc.), voire une médiation ou tout autre moyen de réguler ses relations avec autrui. Ces intentionnalités plus ou moins explicitées par des textes de mission totalement ringards sont à prendre en compte : la question vaut moins que l’environnement dans lequel se situe l’acte judiciaire. La mission du psychologue s’est, en effet, détachée depuis la fin des années quatre-vingt du complément de la mission psychiatrique – qui poussait à faire usage du testing pour apporter au diagnostic sur la pathologie mentale éventuelle des compléments psychodynamiques et une mesure de l’efficience intellectuelle. L’autonomisation des missions a renvoyé les juges vers une utilisation qui fut celle préconisée par Guy Sinoir, avant qu’Heuyer n’y mette le holà (8) – à savoir des approfondissements différenciés, selon qu’il s’agisse seulement de comprendre et d’expliquer, d’orienter ou d’anticiper.
On peut, en effet, utiliser l’examen psychologique dans ces trois perspectives séparément ou concurremment.
Comprendre, c’est seulement apporter un éclairage sur les processus par lesquels le sujet s’est construit jusque-là – ce qu’un bon entretien diagnostique permet souvent de réaliser, du moins avec un sujet qui n’est pas réticent ou trop manipulateur.
Expliquer relève de l’interprétation : l’interprétation la plus probable est celle qui rend compte du maximum de faits grâce à un minimum d’hypothèses, disait Lagache (1949, in Psychologie clinique et méthode clinique – texte toujours aussi moderne). Ce qui est actuel, ce n’est pas forcément le recours au DSM-IV-TR ou autre CIM, mais le fait de citer des références précises, à des théories précises, et non de se réfugier dans un discours clinique « généraliste ». Pour prendre un exemple précis : le psychopathe, tel que compris par Jean-Pierre Chartier, auteur bien connu des lecteurs du Journal des psychologues (9), n’est pas celui décrit par R. Meloy (10) ou par R. Hare. Employer ou non le PCL-R ou le DSM revient donc à faire un choix théorique, en plus d’un choix d’outil, et il devient plus que jamais nécessaire de l’expliciter.
Orienter relève de la projection dans le temps en ayant pris soin d’examiner les capacités de la personne d’assimiler et d’anticiper. Mais, en matière de « réadaptation », terme choisi pour poser sans le dire la question de la récidive, il n’est pas certain que la clinique psychodynamique soit très armée pour répondre, d’autant que ni les tests projectifs ni les tests cognitifs n’ont été construits pour cela. Et l’enseignement des méthodes prédictives en psychologie reste à inventer. On comprend sans doute là pourquoi la psychopathologie classique, celle de la fin du XIXe siècle, fait de la résistance : la triade étiologie-sémiologie-évolution est, en effet, au cœur des descriptions que fit E. Kreaplin et bien d’autres – et elle reste une pensée très fortement ancrée chez les « utilisateurs » : à partir d’une description « ici et maintenant », nous, cliniciens, devrions pouvoir anticiper sur l’évolution. D’où le recours, si fréquent, à la prudente indication d’une thérapie (sans préciser souvent ni le pourquoi ni la nature de celle-ci) pour « conditionner » en quelque sorte le devenir. La discussion sur l’accessibilité du sujet à une thérapie et l’efficacité est pourtant bien intéressante, même si un examen limité ne permet pas de beaucoup s’avancer.
Quelques pratiques innovantes
Les pratiques innovantes au sein d’une institution judiciaire très fragmentée et peu mobilisable ne sont pas faciles à faire émerger. Pourtant, tout n’est pas figé et je vois se dégager plusieurs pistes qui modifient la donne de l’examen « standard ». à titre d’exemple :
l Des magistrats adhèrent à la démonstration que l’inceste étant une interaction familiale complexe, le même expert doit examiner non seulement chaque personne, mais les liens entre ces personnes et font, en ce sens, une demande explicite mentionnée dans la mission. Cela suppose un investissement de travail très particulier, car ce type d’expertise ne peut se faire sans un approfondissement du dossier, et donc quelques bonnes heures de lecture et de prises de notes, puis un rapprochement avec les données cliniques. Les références sont alors autant contextuelles (anthropologiques et sociologiques, notam- ment) que cliniques. Il ne s’agit pas, en effet, d’une analyse de la personne, mais d’une dynamique familiale et d’une histoire sur plusieurs générations. L’affirmation, désormais commune, de la « transgénérationalité » de tel ou tel événement psychique ne suffit pas, encore faut-il en montrer le processus. Pour l’inceste, la technique d’examen de chaque personne compte moins que la construction d’une technique de lecture et d’assemblage des liens et représentations interpersonnelles, ainsi que de l’arbre généalogique.
l La réflexion avance sur la crédibilité des victimes, en ce sens que si l’on n’a pas en fait renoncé à poser la question, il est clairement dit et redit dans des rapports demandés par la Chancellerie que cet examen est différent de celui de l’évaluation du traumatisme. Des techniques d’entretiens spécifiques existent (entretiens cognitifs, protocole du NICDH de Orbach et al. (11) des paradigmes d’observations aussi : reste à les imposer en explicitant clairement les sources qui justifient telle ou telle approche.
l Ce même examen de victime est désormais fortement influencé par les travaux sur la victimisation en général (12) avec les notions sur les réactions immédiates et la chronicité : la recherche de signes spécifiques est souvent demandée. Des questionnaires de coping bien validés sont une aide précieuse quand l’examen a un objectif d’évaluation de préjudice. Ils permettent de sortir de l’affirmation ou non de la présence d’un psychotraumatisme et de conclure sur la seule indication d’une thérapie : le but de l’examen est de décrire les réactions du sujet et de démontrer la nature des séquelles au quotidien, ce qui suppose un entretien minutieux, des références précises sur l’avant et l’après-événement, ainsi qu’un bilan projectif permettant de comprendre l’inclusion de ces symptômes au sein de l’économie psychique.
l Sur l’évaluation de la récidive et la dangerosité, les travaux les plus récents en matière d’agressions sexuelles, notamment, montrent que, dans nombre de pays, une réflexion approfondie sur le diagnostic-pronostic a conduit à construire des questionnaires évaluatifs spécifiques encore peu usités en France. Ch. Mormont et ses collaborateurs en citent de nombreux dans leur étude sur quinze pays européens, où il apparaît qu’en France la clinique projective domine, alors que le svr-20, le STATIC-99, le VRAG et d’autres outils se sont imposés dans beaucoup de pays d’Europe (13). De même, si un entretien structuré, le QICPASS (Balier, Ciavaldini) est utilisé comme entretien de diagnostic dans les SMPR, il n’est pas encore devenu, sous une forme révisée ou adaptée à cette pratique, un outil en matière d’expertise.
Pour conclure
Il n’y a pas de renouveau de l’examen psychologique dans ce champ spécifique de pratique, et l’on ne peut que le déplorer. Les outils restent très traditionnels et, en dehors de « lectures » et analyses particulières de grands tests comme le Rorschach (je pense aux travaux de J.-C. Herault, déjà anciens (14), il n’y a pas de production spécifique d’outils ni d’adaptation faisant date de tests ou échelles produites ailleurs ou pour d’autres domaines. Cela tient en partie à ce que la « forensic psychology » ou « legal psychology » n’est pas une sous-discipline reconnue et qu’il n’y a pas de formation-recherche menant spécifiquement à cette activité, pratiquée pourtant plus ou moins occasionnellement par des centaines de psychologues. Cela provient aussi du fait que cette pratique reste secondaire à une activité différente (psychologue ou psychothérapeute libéral ou en institution) et n’est pas investie spécifiquement en tant que telle avec un questionnement sur le fondement même de l’examen pratiqué (épistémologie et déontologie). Enfin, il est probable également que le peu d’intérêt des demandeurs pour la méthode d’obtention des résultats exposés ne favorise pas une réflexion sur celle-ci. La seule issue à cette situation, que je qualifierai de « casanière », est qu’un référentiel de formation oblige à la développer, que soit ainsi posée la question de la pertinence des examens et de leur maîtrise par les praticiens.
Notes
1. Cela fait trois décennies que l’auteur de ces lignes s’efforce d’y répondre. Certaines sont encore inspirées des missions imaginées par Guy Sinoir, psychologue de l’Éducation surveillée en 1950 ! – occasion de rendre hommage à ce collègue qui comprit très tôt l’importance de l’investigation approfondie en matière de délinquance.
2. PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised) : échelle de psychopathie de R. Hare dont on trouve la description notamment dans Pham T., Côté G., 2000, Psychopathie, théorie et recherche, Presses du Septentrion.
3. Lally J., 2003, « What Test are Acceptable for Use in Forensic Evaluations ? A Survey of Experts », Professional Psychology : Research and Practice, 34 : 5, 491-498
4. Waterman J., Lusk R., 1993, Psychological Testing in Evaluation of Child Sexual Abuse, Child Abuse and Neglect, 17 : 145-159.
5. Non seulement, compte tenu du temps passé, le psychologue gagne un peu moins de deux fois l’heure de smic pour une heure de travail en expertise (avant impôt), qu’il soit débutant ou qu’il ait trente ans d’expérience, mais les parloirs de prison sont des lieux bruyants, étroits, peu accessibles compte tenu des horaires imposés par les directions des établissements.
6. Seule traduction possible de forensic psychologist, dénomination qui a cours partout dans le monde et repris par la Fédération européenne des psychologues (EFPPA).
7. Je montre, un jour, test à l’appui, qu’un sujet déféré devant une cour d’assises est déficient intellectuel. Interrogé par le président, le psychiatre, qui ne considère pas ce sujet comme débile, répond sur cette appréciation : « La débilité psychiatrique et la débilité psychologique, ce n’est pas la même chose… »
8. Sur ce point, voir Viaux J.-L., 2003, Psychologie légale, Frison Roche.
9. Cf. » Psychopathes ou pervers : le faux débat ? «, in Le Journal des psychologues, 211 : 27-30.
10. Meloy R., 2000, Les Psychopathes, Frison Roche.
11. Orbach Y., Hershkowitz I., Lamb M. E., Sternberg K. J., Esplind P. W., Horowitz D., 2000, » Assessing the Value of Structured Protocols for Forensic Interviews of Alleged Child Abuse Victims «, Child Abuse & Neglect, 24 : 6, 733-752.
12. Ceux de Louis Crocq, notamment. Voir à ce sujet ses articles dans le Journal des psychologues, nos 206, 211 et 214.
13. SVR : » Sexual Violence Risk «, VRAG : » Violence Risk Appaisal Guide «. Le » STATIC 99 « de Hanson (1999) est une combinaison d’échelles en dix facteurs. QICPAAS : » Questionnaire d’investigation pour auteurs d’agressions sexuelles «. Tous ces outils sont décrits dans Cornet J.-P., Giovannangeli D., Mormont Ch., 2003, Les Délinquants sexuels, Frison-Roche.
14. Héraut J.-C., 1989, » Le concept de personnalité criminelle à l’épreuve du Rorschach «, thèse de doctorat, Bordeaux