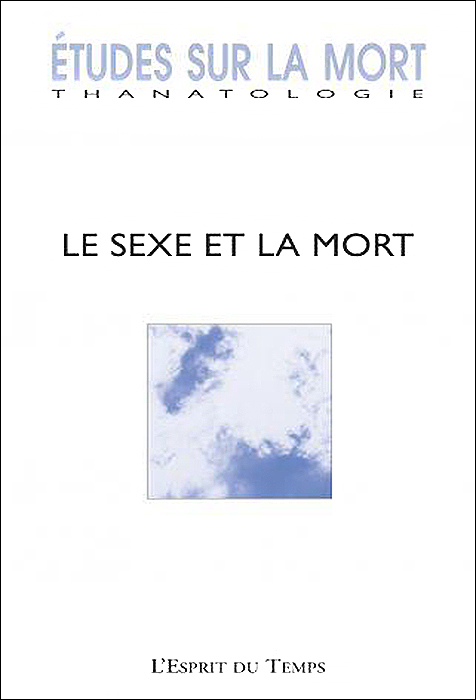Dossier : journal des psychologues n°239
Auteur(s) : Blanchard Anne-Marie
Présentation
L’œuvre littéraire convoque nos résonances esthétiques, mais elles donnent à voir aussi nos efforts pour effectuer un travail de sublimation dans l’acte créateur. L’analyse de la production littéraire d’André Gide est à cet égard exemplaire. L’auteur, par une analyse approfondie de ses textes, met au jour les débordements pulsionnels infantiles et ses effets traumatiques sur la psyché immature du futur écrivain. La réflexion psychanalytique de l’origine du processus créateur chez Gide n’est pas en soi une psychogenèse totalisante. C’est sa vocation d’artiste, et elle seule, qui fait l’unité de sa vie.
Mots Clés
Détail de l'article
Notre attrait pour les œuvres littéraires ne tient pas seulement au fait qu’elles convoquent notre sentiment esthétique, mais aussi, au moins pour certaines d’entre elles, au fait qu’elles cherchent à rendre compte des efforts des créateurs pour exprimer leur expérience de la vie, leurs conflits et la manière dont ils y ont fait face. Elles agissent alors comme des miroirs où nous cherchons à découvrir des traits qui nous concernent, souvent avant même que nous les ayons nous-mêmes identifiés.
L’œuvre d’André Gide, à cet égard, me paraît exemplaire, car elle a été pour son auteur un immense travail non seulement pour se comprendre, mais plus encore pour se construire.
Jean Delay, biographe des plus attentifs, écrit : « Enfant unique, né dans une famille aisée et cultivée, élevé par des parents qui l’aimaient […], André Gide semble avoir grandi dans des conditions privilégiées. Cependant, son enfance qui pouvait paraître heureuse ne l’était pas. Elle fut intérieurement vécue dans un climat de troubles et de tensions nerveuses. »
Gide rapporte lui-même : « Quand j’étais très jeune, il m’arrivait souvent de m’élancer la nuit dans d’effroyables cauchemars dont je sortais tremblant et baigné de larmes […]. On eût dit que brusquement s’ouvrait l’écluse particulière de je ne sais quelle mer intérieure inconnue dont les flots s’engouffraient démesurément dans mon cœur : j’étais moins triste qu’épouvanté… »
Il avait un sentiment permanent de malaise, d’insécurité et d’infériorité qui pesa lourdement sur son enfance. Il était de caractère difficile et surtout déconcertant : ambigu, indécis, hésitant, plein de contradictions, instable, sujet à de brusques défaillances de concentration.
Bien des biographes de Gide ont regretté que nous ne sachions rien sur sa naissance et sa toute petite enfance. Cependant, à travers ses symptômes et ses démêlés avec sa mère, oscillant entre soumission et révolte, on peut avancer des hypothèses sur ses premières relations avec son entourage.
La mère d’André Gide
L’image que nous pouvons nous faire d’elle à travers les écrits de son fils est ambiguë. Gide laisse entrevoir une femme timide, inquiète, profondément défiante d’elle-même, ayant le sentiment de n’être pas aussi bien que les autres.
Mais, à la maison, elle était tout autre, au point que Gide écrit : « Elle était dans son rôle alors même qu’elle me tourmentait le plus : à vrai dire, je ne concevais pas que toute mère, consciente de son devoir, ne cherchât pas à soumettre son fils. »
Elle ne cessait de le corriger, de le rabrouer, de le rabattre, cherchant à lui inculquer le mépris de soi-même. « Je crois que l’on eût pu dire de ma mère, écrit encore Gide, que les qualités qu’elle aimait n’étaient point celles que possédaient les personnes sur qui pesait son affection, mais bien celles qu’elle leur souhaitait d’acquérir. »
On peut en déduire que le petit André fut soumis dès son plus jeune âge à une emprise maternelle implacable à laquelle il se soumit d’autant plus qu’il l’admirait davantage ; pris là aussi, et peut-être surtout là, dans des contradictions insolubles, il oscillait entre dévotion et exaspération.
L’accordage mère-enfant
Essayons d’éclairer quelque peu ce lien paradoxal. Avec une mère avant tout éprise d’un enfant idéal plus que de son enfant réel, la construction du narcissisme primaire n’a pu se faire, entraînant une précarité massive du sentiment d’existence. On sait l’importance, notamment depuis Winnicott et Bion, du rôle de l’objet premier dans la construction du narcissisme primaire. D’emblée, le bébé ne peut s’approprier ses états internes, il a besoin que ses sensations, ses investissements, soient réfléchis par l’objet, que la mère et la famille lui servent de miroir, comme l’a écrit Winnicott dans un de ses articles.
Une anecdote rapportée par Gide dans son livre autobiographique, Si le grain ne meurt, nous le montre, recherchant frénétiquement un écho qui, sans doute, lui a manqué : « Le souci de paraître précisément ce que je sentais que j’étais, ce que je voulais être, un artiste, allait jusqu’à m’empêcher d’être […]. Dans le miroir d’un petit bureau secrétaire que ma mère avait mis dans ma chambre et sur lequel je travaillais, je contemplais mes traits, inlassablement, les étudiais, les éduquais comme un acteur et cherchais sur mes lèvres, dans mes regards, l’expression de toutes les passions que je souhaitais découvrir, surtout j’aurais voulu me faire aimer […]. En ce temps, je ne pouvais écrire et j’allais dire presque penser, me semblait-il, qu’en face de ce petit miroir ; pour prendre connaissance de mon émoi, de ma pensée, il me semblait que, dans mes yeux, il me fallait d’abord les lire. »
Comment mieux exprimer une quête de soi, une quête d’amour, à travers un vécu corporel affectivo-sensori-moteur qui, on peut le supposer, n’a pas été assuré dans les premiers temps de la vie par l’entourage familial, faisant de lui, suivant sa propre expression, un enfant « forclos » ?
R. Roussillon, dans son article « Narcissisme et logiques de la perversion », souligne : « La mère est un double, un double est un même, il reflète le sujet en miroir, mais un double est un autre, il n’est pas à confondre avec soi. »
C’est bien cette distinction entre soi et l’objet qui paraît problématique dans le cas de Gide. Sans doute, sa mère n’a-t-elle pas su, pas pu, lui renvoyer en écho quelque chose des sensations et des émotions qu’il vivait dans un accordage et un ajustement qui lui auraient permis de les reconnaître comme siens dans une rêverie partagée. Ce que Gide nous dit d’elle et de ses principes d’éducation nous fait penser qu’elle se souciait moins des besoins de son fils que de ce qu’elle pensait de son devoir de lui transmettre, à savoir avant tout l’idéal religieux et moral dont elle avait elle-même hérité.
Le père d’André Gide
Et son père ? Voici ce qu’il en dit, dans Si le grain ne meurt : « Accaparé par la préparation de son cours à la faculté de droit, mon père ne s’occupait guère de moi. Il passait la plus grande partie du jour, enfermé dans un vaste cabinet de travail un peu sombre, où je n’avais accès que lorsqu’il m’invitait à y venir […]. Je ressentais pour mon père une vénération un peu craintive, qu’aggravait la solennité de ce lieu. J’y entrais comme dans un temple ; dans la pénombre se dressait le tabernacle de la bibliothèque. »
Malgré cette présentation assez austère, Gide rapporte des souvenirs très joyeux des jeux et des promenades qu’il faisait avec son père et surtout des lectures, à voix haute, qui l’entraînaient dans cet univers qu’il appelait « la seconde réalité ».
Il écrit qu’après la mort de son père – qu’il perdit alors qu’il n’avait que onze ans –, il s’imaginait qu’il n’était pas mort pour de vrai : « Il n’était mort qu’à notre vie ouverte et diurne, mais, de nuit, secrètement, alors que je dormais, il venait retrouver ma mère. »
Les deux parents avaient des idées très divergentes sur l’éducation : la mère était d’avis que l’enfant devait se soumettre sans chercher à comprendre ; le père, au contraire, avait tendance à tout expliquer. « Je crois, écrit-il, que mon père cédait au besoin de son cœur plutôt qu’il ne suivait une méthode lorsqu’il ne proposait à mon amusement ou à mon admiration rien qu’il ne pût aimer ou admirer lui-même. »
On voit que le père ne manquait pas d’empathie pour son fils, qu’il n’appelait jamais autrement que son « petit ami » ; mais il craignait les conflits conjugaux et préférait rester en retrait et laisser à sa femme la mainmise sur le petit André.
Et Gide de conclure, à la fin de sa vie : « Je crois que si mon père s’était occupé lui-même de mon éducation, ma vie aurait été bien différente. »
Le débordement pulsionnel
On entend là une souffrance qui évoque notamment les années d’errance qui suivirent la mort de son père. Ces années furent marquées par une accentuation de ses troubles psychologiques au point qu’il ne put suivre aucune scolarité et persuada sa mère et les neurologues qu’elle consultait que ses crises nerveuses contre-indiquaient tout effort intellectuel. Cela nous donne à réfléchir sur l’impossibilité d’acquérir des connaissances quand l’intégration des toutes premières relations n’a pu se faire. L’agitation nerveuse vient témoigner de l’incapacité de contenir le débordement pulsionnel et ses effets traumatiques sur la psyché immature de l’enfant.
De son incapacité de contenir et transformer ce que Bergeret nomme la « violence fondamentale », Gide a donné maints exemples. Dès les premières pages de Si le grain ne meurt, il parle de ses « mauvaises habitudes » et de sa recherche du plaisir, dont il constate la présence aussi loin que sa mémoire remonte en arrière.
Dès son enfance, il fut hanté par des masturbations compulsives. À l’âge de huit ans, lors de son entrée à l’école alsacienne, il fut renvoyé pour trois mois, ayant été surpris par le maître en train de se masturber en classe. On imagine sans peine la consternation de sa mère qui l’emmena sur le champ chez le médecin. André s’efforça, sous la menace énoncée par ce dernier, de réprimer ses tendances, mais il fut alors envahi de fantasmes autour de l’idée de s’abandonner, de se perdre, de s’anéantir dans des formes obscures, l’impression de se dissoudre dans un élément aquatique.
Ses masturbations récurrentes jusque dans l’âge adulte s’accompagnaient de vifs sentiments de culpabilité. Il s’identifiait aux pires gredins, se sentant, comme il le fera dire au petit Boris des Faux Monnayeurs, criminel, persuadé que ses pratiques solitaires avaient reçu leur châtiment en provoquant la mort de son père.
Une autre anecdote paraît révélatrice. Alors qu’à quatre ou cinq ans il était en visite avec ses parents chez une cousine, très belle, et qu’elle se penchait pour l’embrasser, il relate : « Devant l’éclat de cette chair, je ne sais quel vertige me prit : au lieu de poser mes lèvres sur la joue qu’elle me tendait, fasciné par l’épaule éblouissante, j’y allai d’un grand coup de dents. »
Gide nous donne beaucoup d’autres exemples de sa difficulté à réguler ses affects non seulement dans son enfance, mais aussi dans son adolescence et même à l’âge adulte ; toutes ses relations eurent un caractère passionnel, qu’elles soient ou non ouvertement sexualisées. Il semble qu’il cherchât toute sa vie et même dans son œuvre à exalter ses sensations et ses émotions comme si cet excès lui était indispensable pour se sentir exister.
Cela fut manifeste dans les rares relations qu’il noua avec des camarades de vacances et encore bien plus lorsqu’il tomba amoureux, dès l’âge de treize ans, de sa cousine Madeleine Rondeaux, fille d’un frère de sa mère.
Madeleine
Ce fut, au moins pour une part, son identification à la détresse de sa cousine, bouleversée par l’inconduite de sa propre mère, qui fut à l’origine de sa passion.
Cela souligne une fois de plus sa sensibilité au traumatisme et sa quête d’un miroir qui lui renvoie quelque chose de son propre malaise. En effet, ce qu’il rechercha en elle, comme plus tard dans la création des personnages de son œuvre, ce fut un double de lui-même ou de l’être qu’il aurait voulu être.
Madeleine incarnait aux yeux d’André une sorte de perfection morale, mais surtout elle présentifiait la détresse de l’infans : « Je sentais que dans ce petit être, que déjà je chérissais, habitait une grande, une intolérable détresse, un chagrin tel que je n’aurais pas trop de tout mon amour, toute ma vie, pour l’en guérir. » Madeleine appartient à cette invisible réalité, à cet univers de mystère qui introduit à l’univers mystique : « J’avais erré jusqu’à ce jour à l’aventure ; je découvrais soudain le mystique Orient de ma vie. »
L’influence de Madeleine, ou plutôt de l’image qu’il projetait sur elle, fut pour beaucoup dans le revirement qui s’opéra en lui aux environs de sa seizième année, faisant de lui un adolescent ascétique, religieux, voire mystique, et un travailleur acharné. Il rattrapa en dix-huit mois le retard accumulé lors des années précédentes où il avait mené une vie « désencadrée ». « L’intérêt extrême que je prenais à tout désormais venait surtout de ceci que m’accompagnait partout Madeleine. Je ne découvrais rien que je ne l’en voulusse aussitôt instruire et ma joie n’était parfaite que si elle la partageait. »
Ce moment coïncida avec sa première communion qui le maintint, des mois durant, dans une sorte d’état séraphique qu’il entretenait par des macérations : « Levé dès l’aube, je me plongeais dans l’eau glacée […], puis, avant de me mettre au travail, je lisais quelques versets de l’Écriture […]. Je dormais sur une planche, au milieu de la nuit je me relevais, m’agenouillais encore […]. Il me semblait alors atteindre l’extrême sommet du bonheur. »
Nul doute qu’il n’y ait là encore, inconsciemment, une recherche de sensations qui exaltât son sentiment d’existence.
C’est dans cette tourmente émotionnelle qu’il prit la ferme décision de terminer son premier livre avant la fin de sa vingtième année.
Le premier livre
« Un livre, un projet de livre, habitait uniquement mon cœur, m’occupait tout entier, me désœuvrait de tout le reste. C’était André Walter que déjà je commençais d’écrire. »
Il se persuadait que son livre et son amour pour Madeleine ne faisaient qu’un, car ce livre lui apparaissait « comme une longue déclaration d’amour […], une déclaration si noble, si pathétique, si péremptoire, qu’à la suite de sa publication, [leurs] parents ne [pourraient] plus s’opposer à [leur] mariage, ni Madeleine [lui] refuser sa main. »
L’avenir devait, pendant un temps, contrecarrer ce rêve : il essuya un refus de la part de sa cousine. Mais il s’obstina, il attendrait le temps qu’il faudrait… Si André Walter servait de miroir à André Gide, Madeleine, elle, ne supporta pas d’être exposée dans le personnage d’Emmanuelle.
Même si André Gide fut extrêmement blessé par ce refus, son œuvre était en route et, tout compte fait, c’est d’elle qu’il attendait la vie. D’elle, mais aussi de nouveaux projets qui devaient être décisifs pour lui. Il décida de partir en voyage en Afrique du Nord avec un ami, et donc de quitter sa mère dont il ne s’était pas séparé un seul jour jusqu’à sa vingtième année. Bien qu’il fut gravement malade pendant ce voyage, il s’adonna tout entier à ce que l’on pourrait appeler le « retour du refoulé ».
Le nouvel être
Ménalque, héros de L’Immoraliste et des Nourritures terrestres, est le chantre de ce nouvel être. Il veut la vie pour la vie. Les « joies de la chair et des sens qui paraissaient à A. Walter condamnables parce qu’il y voyait le péché sont celles que recherche Ménalque. » La sensation est son guide de vie.
Gide écrit dans les Nourritures terrestres : « J’ai peur que tout désir, toute puissance que je n’aurai pas satisfaits durant ma vie, pour leur survie ne me tourmentent. »
Si Ménalque consent à l’ascétisme, c’est pour y trouver un piment à ses sensations : « Je me plaisais à d’excessives frugalités, mangeant si peu que ma tête en devenait légère et que toute sensation me devenait une espèce d’ivresse […]. Le pain que j’emportais avec moi, je le gardais parfois jusqu’à la demi-défaillance ; alors, il me semblait sentir moins étrangement la nature et qu’elle me pénétrait mieux ; c’était un afflux du dehors ; par tous mes sens ouverts, j’accueillais sa présence ; tout en moi s’y trouvait convié. »
Le nouvel être est celui qui, ignorant tous les interdits, retrouve la pureté originelle des émotions et s’applique à jouir le plus possible du plus grand nombre pour éveiller en soi-même la ferveur. Il doit rompre avec toutes ses attaches, être un déraciné, pratiquer le « nomadisme ».
On sait toute l’ambiguïté de Gide. À peine eut-il écrit les Nourritures terrestres qu’il lui fallut écrire Saül, comme son antidote, montrant qu’une disposition trop passive à l’accueil ne menait qu’à la dissolution de la personnalité.
Les premières expériences sexuelles
Cependant, cette soif de sensations, cette ouverture au monde, ce refus de se soumettre aux impératifs de sa mère et l’éloignement de sa cousine qui refusait même de répondre à ses lettres, eurent des effets sur sa sexualité. Les deux jeunes gens étaient d’ailleurs partis avec le désir explicite d’oser tenter des expériences sexuelles. Si André Walter affirmait que les possessions charnelles l’épouvantaient, Ménalque était bien décidé à jouir de tous ses sens. Les amours d’André Gide et de Madeleine Rondeaux avaient été des plus chastes, chacun se persuadant que « le plaisir est plus pur, l’amour plus parfait si le cœur et les sens ne s’entrengageaint point ». Fort de ce clivage, André Gide était prêt à rester fidèle à son amour, tout en usant de ses sens. Il eut effectivement ses premières relations sexuelles avec une prostituée, mais fut aussi séduit par de jeunes garçons. Déjà, dans André Walter, il raconte des rêveries qui ne sont pas sans évoquer une attirance sensuelle sinon sexuelle. Il imagine l’enfant qu’il aurait voulu être en voyant des enfants qui se baignent dans une rivière : « Des rages me prenaient de n’être pas des leurs, un de ces vauriens des grandes routes, qui, tout le jour, maraudent au soleil, la nuit s’allongent dans un fossé sans souci du froid ou des pluies et, quand ils ont la fièvre, se plongent, nus tout entiers, dans la fraîcheur des rivières […] et ne pensent pas […] ; je jouissais douloureusement de ma solitude […]. »
Ce sont ces jeunes garçons qu’ils retrouvent à Sousse, une bande de vauriens, dit-il, qui fainéantisaient aux abords de l’hôtel et se proposaient en riant. Après un rapport avec l’un d’eux, il s’exclame : « Son corps était peut-être brûlant, mais parut à mes mains aussi rafraîchissant que l’ombre. Que le sable était beau ! Dans la splendeur adorable du soir, de quels rayons se vêtait ma joie ! » Il précise : « Pour moi, je ne comprends le plaisir que face à face, réciproque et sans violence, et, souvent, pareil à Whitman, le plus furtif contact me satisfait. »
La pédérastie telle qu’il la pratiqua tenait plus à une recherche fébrile d’excitation qu’à une rencontre sexuelle. En ce sens, elle était le prolongement de ses masturbations compulsives ; l’autre, l’enfant, ne semble jamais l’avoir préoccupé. Pourtant, lorsqu’il s’intéressait à l’un d’eux, son désir d’éduquer venait contrarier ses penchants sexuels. Il n’était plus alors le pédéraste identifié à l’enfant et recherchant une excitation et des sensations corporelles partagées, mais le pédagogue sans doute identifié à sa mère.
Ses tendances pédophiles l’inquiétèrent énormément. Quand quelques mois après la mort de sa mère, sa cousine accepta enfin de répondre à son amour indéfectible, il consulta un médecin et lui confia son problème. Ce neurologue de renom l’encouragea à se marier, lui disant : « Mariez-vous sans crainte. Et vous reconnaîtrez bien vite que tout le reste n’existe que dans votre imagination. Vous me faites l’effet d’un affamé qui, jusqu’à présent, cherchait à se nourrir de cornichons. Ce qu’est l’instinct naturel, lorsque vous serez marié, vous aurez vite fait de le comprendre, et tout spontanément d’y revenir. »
Cependant, un fois marié, force lui fut de constater que son propre corps se refusait aux désirs les plus légitimes de son amour. Ce mariage dont il avait attendu tant et depuis si longtemps, il ne put le consommer.
Dans ses lettres à P. Claudel et à F. Jammes, il parle de « cette écharde dans sa chair » qui empêchait non son amour pour Madeleine, mais l’assentiment de son corps à cet amour. Le sentiment de n’être pas comme les autres qui avait fait le désespoir et l’humiliation de sa préadolescence revint en force et fit qu’il se persuada d’avoir une constitution particulière.
Dans un premier temps, il se sentit coupable : « Une énorme réserve d’amour me gonflait ; parfois, elle affluait du fond de ma chair vers ma tête et dévergondait mes pensées. » (L’Immoraliste.)
Il cherchait à se disculper, comme il l’écrit dans Et nunc manet in te : « Je trouvais avantage à supposer une cécité (chez elle) qui permettait, sans trop de remords, mon plaisir, puisque, aussi bien mon cœur ni mon esprit ne s’y engageaient, il ne me paraissait pas que je lui fusse infidèle en cherchant en dehors d’elle une satisfaction de la chair que je ne savais pas lui demander. Au surplus, je ne raisonnais pas. J’agissais en irresponsable. Un démon m’habitait. »
Plus tard, il ira jusqu’à soutenir que l’amoureuse prise en charge par un homme mûr d’un adolescent en plein devenir est pour celui-ci le plus profitable des systèmes d’éducation.
Dans Corydon, Gide se fait le défenseur de l’homosexualité. Il entend plaider sa cause le front haut et démontrer que l’homosexualité n’est nullement contre-nature. Cependant, note Jean Delay, « Gide restera toute sa vie l’André Walter que les possessions charnelles épouvantent, aussi étranger à l’agressivité virile qu’à la passivité féminine. Sa sexualité se réduit à des jeux puérils ».
Ce ne fut que bien plus tard, à plus de cinquante ans, que Gide se prouva qu’il n’était pas incapable « de l’élan qui procrée ». Il eut une liaison et une enfant qu’il reconnut après la mort de Madeleine. Cet événement ne fait que confirmer l’ambiguïté foncière de Gide.
En somme, c’est sa vocation d’artiste, et elle seule, qui fait l’unité de sa vie.
L’artiste
Gide écrit dans son journal de 1923 : « Je n’ai jamais rien su renoncer et, protégeant en moi à la fois le meilleur et le pire, c’est en écartelé que j’ai vécu. Mais comment expliquer que cette cohabitation en moi des extrêmes n’amenât point tant d’inquiétude et de souffrance qu’une intensification pathétique du sentiment de l’existence de la vie ? […] Je ne souhaitais point d’échapper à ce qui mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être. Cet état de dialogue, qui pour tant d’autres est à peu près intolérable, devenait pour moi nécessaire […]. Il m’invitait à l’œuvre d’art […], aboutissait à l’équilibre, à l’harmonie. »
Que Gide ait effectivement réussi dans son œuvre à trouver équilibre et harmonie n’est pas douteux. Si, dès son premier livre, il avait exposé l’essentiel des contenus qui feraient son œuvre, il lui faudrait des années pour le dire avec ordre et clarté, comme s’il devait renoncer à donner un double total de lui-même et travailler patiemment à des doubles partiels et successifs. Il lui faudrait se soumettre aux lois communes du discours qui feraient de lui l’écrivain classique qu’il souhaitait devenir et qu’il devint. ■
BibliographieGide A., 1932-1939, Œuvres complètes, Paris, Gallimard. |