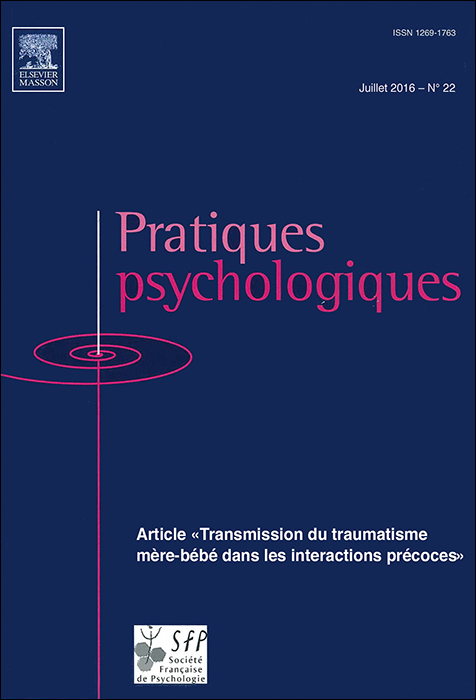Dossier : journal des psychologues n°251
Auteur(s) : Klein Jean-Pierre
Présentation
Lorsqu’un enfant a été l’objet de maltraitances, comment l’aider à se reconstruire sur ces traumatismes irreprésentables, que des mots, seuls, ne sauraient exorciser, mais le plongeraient à nouveau dans un réel insupportable ? L’art-thérapie en proposant de recourir à l’imagination deviendrait source de créations dont l’enfant serait l’auteur et dans lesquelles il pourrait reporter toutes ses terreurs.
Mots Clés
Détail de l'article
Au décours des violences
Au décours de violences sexuelles faites à enfants, les deux dispositions habituelles mises en œuvre peuvent se révéler insatisfaisantes :
• Se fixer sur le trauma et « en parler ». L’évocation insistante de l’horreur tourne souvent vite à son invocation, la parole sur l’acte équivalant presque à l’acte lui-même, le réitérant et le perpétuant dans une obsession mortifère.
• Essayer, illusoirement, d’occulter l’événement, de proscrire tout ce qui pourrait le rappeler, à la limite faire comme s’il n’avait jamais eu lieu. On sait que l’« oubli » est en fait un refoulement dans l’inconscient, source de souffrance mentale et de reproduction ultérieure de la même figure originelle, les enfants martyrs d’hier (ou descendants d’adultes martyrs d’hier) pouvant tomber dans la victimologie ou, au contraire, pouvant devenir les tortionnaires d’aujourd’hui, faute d’avoir pu dépasser les traumatismes dont eux-mêmes, ou leurs parents, ont été les victimes. Ainsi, dit-on, se perpétue éventuellement la tragédie humaine : l’agneau immolé, s’il en réchappe, devient souvent loup à son tour. Mais croire et faire croire en cette inéluctabilité revient à continuer de faire peser la malédiction sur des victimes marquées à jamais et reprenant à leur compte le travail de destruction. C’est poursuivre le travail des bourreaux.
La victime revit en effet imaginairement, jour après jour, nuit après nuit, les actes passés, car l’imaginaire paralysé ne peut que répéter à l’identique la réalité inimaginable. La violence se répète inchangée dans sa tête, ce n’est pas le souvenir du passé mais une réminiscence obligée, présentification automatique, qui s’impose.
Avec un enfant, cet être en devenir permanent, comment peut s’opérer la constitution progressive de son identité si une expérience de néantisation l’envahit à jamais ? Comment, malgré tout, intégrer dans une constitution optimale de la personne ce qui a voulu l’annihiler et nier sa temporalité comme si son identité se résumait, dorénavant, à un rôle de victime née de cet événement, jouant comme un mythe refondateur de son existence arrêtée ? Comment faire le deuil de soi-même, mort au dynamisme de la vie, mort à l’estime de soi dénié, anéanti ? La conception infantile de la mort consiste avant tout à se figer dans l’immobilité, c’est ce que l’enfant a éventuellement vu d’animaux morts, c’est ce qu’il joue quand il la mime « pour de rire ».
Les pédophiles, les incestueux, les violeurs, l’ont fixé dans l’immobilité, le maintiennent dans une injure qui le cloue à jamais, dans une visée de destruction du vivant, de la fluidité de la vie. Le traumatisme est perpétuation de l’acte d’annihilation. Sa survenue a comme arrêté le temps, et l’esprit le reproduit en boucle de façon quasi hallucinatoire. Ce qui lui est arrivé est irreprésentable et il ne peut y effectuer le travail psychique habituel qui consiste à donner un mouvement interne imaginaire au réel trop offensant.
Rencontre avec le professionnel
Le traumatisme est là, toujours présent en chacun des interlocuteurs : l’intervenant dont il justifie la présence, l’enfant meurtri en déperdition depuis l’effraction symbolique et physique de son intégrité et, surtout, la perte de soi comme objet aimable et digne. Son besoin naturel de tendresse physique a été dévoyé et le traumatisme est encore plus terrible lorsque ceux qui sont en charge de protéger la personne sont les auteurs des violences, tout s’effondre alors quant aux possibilités d’avoir recours à un référent solide de « pare-excitation » (dont je rappellerai que c’est un concept proposé par Freud dès l’Esquisse d’une psychologie scientifique de 1895 [Freud S.], que l’on pourrait définir comme une protection contre les stimuli et l’excitation interne qui leur est associée) : parents, prêtres, enseignants, soignants, responsables d’associations,… qui trahissent leur rôle symbolique de façon criminelle ! Nous avons aussi eu connaissance de viols devant des parents réduits à l’impuissance ou, comble de l’horreur, de parents filmant, à des fins de revente, les viols de leurs enfants…
Le défi pour l’enfant ne consiste pas à se (re)construire malgré cela, mais à se construire sur cela, grâce à une « assimilation » (au sens digestif du terme), à une métabolisation de la violence subie.
Que faire alors ?
Comment être thérapeutique à partir de ce meurtre symbolique opéré par le violeur, le maltraitant, l’incestueux, qui a entraîné un état de non-vie, immobilisation de l’existence dans la répétition du trauma qui n’est originel que de son évocation à jamais ?
La création comme processus de transformation
On dit couramment qu’il faut parler, parler pour libérer (d’où la prolifération des cellules d’aide d’urgence psychologique après un trauma grave collectif, qui est l’alibi pour les pouvoirs publics pour se déculpabiliser en n’examinant pas leur responsabilité dans l’« accident », mais cela est une autre histoire). J’en suis d’accord pour un premier temps, mais cela peut s’avérer insuffisant. Il ne s’agit pas de cesser de parler d’abord en direct des actes (en particulier à la police, mais je ne traiterai pas ici de cet aspect), mais de tenter de (se) créer ensuite sans consigne particulière.
Comment symboliser face à la circularité post-traumatique due, comme le dit le psychanalyste R. Roussillon, à l’impossibilité de se représenter l’objet. C’est « la transformation du rapport du sujet à la trace mnésique des expériences antérieures qui rend possible le passage de la présentation hallucinatoire à la représentation symbolique (Roussillon R., 2000) ». Pour cela, la psyché doit passer par un transfert dans des objets animés et inanimés pour « prendre forme ». Il en donne pour exemple le médium malléable que constitue la pâte à modeler, objet utilisé pour le jeu et jeu utilisé comme un objet de plaisir.
Une réponse parmi d’autres est ainsi fournie par la thérapie créatrice (dite aussi « art-thérapie ») qui propose d’utiliser comme un muscle l’imagination, cette faculté irremplaçable pour intégrer, digérer, transformer même toutes les épreuves de la vie, y compris les plus dures, et les plus obsédantes, cette capacité naturelle de conjurer les peurs et d’intégrer tout ce qui terrifie. Mais, bien sûr, en ne la centrant pas sur ce qui fut subi qui ne peut se représenter. La création que ce dispositif va déclencher sera forcément nourrie de ce que l’enfant a vécu, à la condition qu’on ne le lui demande pas expressément.
Cela va lui permettre non seulement d’exorciser les violences subies, mais aussi de construire là-dessus : il a été l’objet d’actes ou de spectacles trop violents ? Par le dessin, le modelage, le collage, la peinture, l’invention d’histoires, la production de rythmes, l’expression corporelle, le travail de la voix, etc., il va être le sujet, l’auteur de sa propre invention, transférant ses terreurs dans son œuvre.
C’est, entre autres, ce que nous ont enseigné deux années de séminaires et colloques que j’avais organisés, de 1993 à 1995, au ministère de la Santé, en tant que président du Collège international de psychiatrie infanto-juvénile sur le thème : « Conduites à tenir avec des enfants victimes de traumatismes graves dans leur réalité(*) ».
Le travail respectueux favorisera prudemment l’expression (sans lui en dicter le contenu) sur des supports variés, dans la distance de la fiction ou de la forme ludique ou artistique, ce qui est étonnamment plus facile que prévu. Il n’y a pas à rechercher une transposition trop immédiate qui serait juste de l’expression directe qui, lorsqu’elle soulage, ne le fait que transitoirement. Des contenus horrifiques ne manqueront pas de venir qui amorcent un déplacement sur le contenu : personnages terrifiants et menaçants du monstre, de l’ogre ou de la sorcière, ou bien cataclysmes naturels ; ou sur la forme : violence du geste, des couleurs, de l’émission vocale. C’est alors que, peu à peu (il ne faut pas l’y forcer artificiellement), l’enfant pourra commencer à créer et à procéder à des transformations du contenu premier.
Il n’est pas important que l’histoire inventée finisse bien, que les violences figurées dans le dessin se résolvent, que les musiques s’apaisent, le simple fait pour l’enfant d’être actif sans risque lui permet de se réintégrer et de manipuler ce qui l’a envahi dans la réalité, en faisant basculer celle-ci dans le symbolique dont il n’est pas toujours opportun de dévoiler les significations. Il me semble délicat de commenter ses productions en soulignant leur lien avec les violences subies, cela n’aurait alors qu’un effet cathartique sans intérêt, s’il ne s’intègre pas dans un processus, et empêcherait le déroulement des créations faisant processus de transformation, rétablissant ainsi la temporalité dans un temps subjectif arrêté. Le territoire protégé de l’expression symbolique aide l’enfant à conjurer l’effet de réel trop violent qui l’a débordé, elle lui permet de redevenir sujet de lui-même.
Si l’on respecte les tentatives imaginatives de l’enfant ou l’adolescent, il faut d’abord se contenter de peu et puis, progressivement, surtout si l’on ne cherche pas à les provoquer, des représentations terribles seront produites dont il n’y a pas à s’effrayer, puisque le fait même d’en être l’auteur lui assure déjà un début de maîtrise. Ne confondons pas l’énoncé comme produit élaboré et l’acte d’énonciation. Le travail avec lui sur ses productions imaginaires, sans révélation de leurs significations inconscientes ni évocation insistante de la réalité vécue, met en place un accompagnement de créations dans une sorte de parcours symbolique, façon de dépasser l’horreur des épreuves endurées.
La transmutation s’accomplit ainsi dans l’imaginaire sous forme de productions projectives successives que l’intervenant accompagne et permet d’évoluer d’une fois sur l’autre. Cette approche est des plus efficaces pour apaiser un peu les tourments, réintroduire de la temporalité et réinsuffler de la vie là où il n’y avait qu’immobilisation par peur de la destruction. Pour cela, il faut en passer par les jeux, les simulacres, les inventions formelles, bref la « fiction », cette faculté humaine qui, à l’état de veille ou de sommeil, permet de conjurer le mal, en somme la fiction (gardant son statut de fiction) comme traitement de la réalité.
Parfois, ce n’est qu’à l’âge adulte que ces blessures ouvertes peuvent commencer à cicatriser : cette femme d’une quarantaine d’années, en formation aux médiations artistiques et à l’art-thérapie dans mon institut, nous avait fait jouer ses viols répétés en « Théâtre de la Réminiscence », afin d’en extraire la quintessence (théâtralisation du souvenir d’autrui qui en dirige le jeu, mais ne le joue jamais lui-même), ce qui lui avait beaucoup apporté, car les « acteurs » formés à cet exercice n’avaient en rien édulcoré les actes violents qu’elle avait subis de la part d’un prêtre pédophile, directeur d’une institution et auteur réputé de livres de pédagogie, qui l’avait maudite quand elle avait réussi à s’enfuir. Mais, c’est en jouant un rôle de femme violée dans le souvenir d’une autre, inspiré par le précédent, qu’elle a pu confirmer son travail de dépassement de son traumatisme.
Relever le défi suprême de parvenir à étayer l’édification d’une personnalité riche sur fond de malheur, en métabolisant les événements traumatiques dans une symbolisation libératoire d’abord, évolutive ensuite, c’est alors que nous pourrons prétendre avoir vaincu le mal en le positivant comme matériau pour la reprise de la construction optimale de soi-même.
La victime passe du statut d’objet de sévices à celui de sujet d’une œuvre d’imagination. Les violences sont déplacées dans la production d’une création personnelle faisant processus de transformation de la réalité vécue. L’enfant participe ainsi à sa propre reconstruction sans pour autant œuvrer dans le rappel de ce qu’il a subi.
L’enfant, objet de traumatismes, est condamné à cette mutation alchimique, si l’on veut qu’il ne soit plus réduit à être le rêve de sa propre mort (comme l’écrit Bernard Noël [1993] « Nous sommes tous rêvés par notre mort, en attendant que son réveil nous tue »), si l’on veut qu’il devienne enfin sujet le plus libre possible de sa destinée.
Dans un livre qui vient de paraître (Klein J.-P., 2006), j’analyse des exemples de thérapies avec médiations artistiques d’enfants et d’adolescentes, victimes de viols et attouchements, selon des médiations diverses : dessins, inventions d’histoires ou de dialogues, jeux de marionnettes, dont on peut suivre la progression grâce à une description précise de la répartition des rôles entre les personnages. Mais je rapporterai ici, plutôt, en référence à des histoires qui ont bouleversé à juste titre le public, le cas du doute ou de l’indécidabilité d’allégations d’un enfant.
Du mensonger prescrit au caché travesti
Elsa, éducatrice, rapporte dans le cadre d’une supervision que j’organise, l’histoire d’une petite fille de huit ans qui est en hôpital de jour. Nous l’appellerons « Minette », prénom plus ou moins équivalent d’un autre très évocateur de petite fille prépubère, allumeuse d’hommes mûrs. Cette fillette est arrivée dans ce centre, envoyée en catastrophe d’un autre, dont il est dit qu’elle l’a mis en péril. En effet, elle a dénoncé à ses parents des pratiques sexuelles d’un infirmier qui l’aurait photographiée nue et d’un médecin qui l’aurait « touchée ». Ses parents ont porté plainte auprès de la police, ce qui a provoqué une poursuite judiciaire aboutissant à un non-lieu : non seulement les soignants ont été innocentés, mais Minette a été accusée d’entraîner dans les toilettes des garçons ou des filles pour se livrer à des attouchements.
On peut déjà décrire le circuit suivant : la parole dite à ses parents a déclenché un acte (une enquête), pour mettre en évidence des actes dont elle aurait été l’objet. En fait, c’est elle-même qui a été convaincue d’être l’auteur d’actes délictueux. Le dilemme n’a été que de confirmer ou d’infirmer la vérité et personne n’est allé plus loin de ce qui avait fonction d’appel. La parole a été agissante dans la réalité même et puis elle a été disqualifiée, et l’accusation s’est retournée contre elle, la situant à la fois comme menteuse et comme délinquante. La culpabilisation d’autrui s’est mue en culpabilité personnelle.
Dans son hôpital de jour actuel, elle se trouve en fusion avec une soignante du groupe : collage personnel se terminant par des gestes violents de Minette que l’on est obligé de séparer de l’adulte. L’institution doit introduire un tiers : Elsa, pour résoudre la dyade conflictuelle.
Dans ses accusations, Minette a-t-elle fait allusion à une version génitale d’une relation fusionnelle ou bien allusion directe, comme elle l’a prétendu, à des actes sexuels, ce qui reviendrait à prendre au pied de la lettre ses accusations ? Ou bien a-t-elle décrit des actes réels en les imputant à quelqu’un d’autre ? On n’en sait rien et l’accession à la vérité est barrée pour l’instant.
Dans sa prise en charge individuelle, elle mélange ses peintures avec les mains et nettoie tout à grandes eaux. Elsa arrête le manège en ne proposant plus d’eau, ce qui permet d’obtenir des dessins formés qui ne sont pas que des traces à effacer.
Le monde de Minette est divisé entre bonnes et mauvaises personnes, mais Elsa ne se sent pour sa part ni mauvaise ni bonne, ce qui ne semble pas le cas de sa collègue qui se veut salvatrice de la victime face à ses bourreaux (l’analyse transactionnelle étudie bien ces cas de figure). Elsa perçoit l’enfant comme une « petite fille de sept ans [il y a un an] ni nourrisson fusionné ni jeune fille génitalisée ».
Depuis l’âge de un an, cette enfant a subi neuf hospitalisations successives, pour convulsions hyperthermiques, douleurs abdominales, végétations, constipations, vomissements nocturnes. La mère elle-même essaie d’obtenir pour sa part le statut de handicapée du fait de maux de ventre et d’estomac.
Minette s’éveille, après une heure de sommeil, prise de spasmes. Elle voit la porte de sa chambre bouger, c’est un cauchemar éveillé dont elle ne se souvient pas le lendemain. Rappelons, au passage, de ne pas oublier les réflexes médicaux de prescription, en bonne clinique, d’un électroencéphalogramme du fait des convulsions et de l’amnésie postcritique, à la recherche d’une épilepsie du type temporal, par exemple. Le diagnostic est peu probable, mais il est nécessaire de l’éliminer.
Comme autres éléments familiaux, il faut signaler que Minette porte le nom de sa mère qui n’a pas voulu que le père la reconnût. Ils disent, bien que vivant ensemble, qu’ils sont séparés. Il y aurait eu aussi le signalement par les voisins d’une possible maltraitance de la grande sœur qui porte le nom du père, mais on n’en sait pas plus. Quant au père, il est handicapé, son bras droit a été sectionné lors d’un accident.
Elsa demande à Minette de figurer en dessin ses cauchemars. Elle se représente au lit, entourée d’un tracé bleu de protection, elle dessine la porte à gauche de son lit et puis la chambre de ses parents, puis, entre les deux, celle de sa sœur qui la protège. Un soleil convenu surplombe le dessin en haut et à gauche. Qui protège qui ? Sa sœur la protège, a-t-elle voulu protéger sa sœur d’abus qu’on ignore ? De toute façon, la vérité est inconnaissable pour l’instant et l’on ne peut, à son propos, qu’associer sur bien des possibilités (scène de coït perçue derrière la porte, etc.) qui ne révèlent que nos associations projectives. Il faut bien se garder de considérer ses productions comme un document du type reportage, tout en restant vigilant.
Constatons que ce qu’elle décrit dans sa parole et dans ses dessins peut se formaliser comme : être objet d’effractions ou de malveillance d’êtres mauvais. Elle n’a d’ailleurs plus de cauchemars depuis son premier dessin.
Pousser l’imagination
Que faire pour l’aider ? La réponse selon moi repose sur deux principes : ne pas lui demander une parole sur la réalité, pousser même les dessins vers une plus grande distance, de telle sorte qu’ils ne traitent pas de la réalité. Déjà, elle a figuré un buisson dont elle dit que quelqu’un de méchant s’est caché derrière ou bien un loup menaçant avec plein de dents, cependant qu’elle ne se représente plus ayant besoin d’un contour protecteur.
Il s’agit pour l’instant de délimiter davantage le territoire de la fiction, sans répercussion sur la réalité, et des horreurs viendront, sans doute, qui diront à leur façon une vérité qui, peut-être, se révèlera, comme cela arrive objectivement, de façon apparemment fortuite, au cours d’une thérapie se déroulant dans le symbolique. Non pas par un décryptage des productions, mais au contraire par un respect des fictions présentées, sans y rechercher ce qu’elles révèlent.
Je me rappelle cet enfant que j’ai suivi : il était élevé par son oncle paternel et sa femme, car sa mère malade mentalement ne pouvait le garder. Le père de cet enfant était décédé, et régnait sur cette mort un mystère que j’ignorais moi-même. Je ne les avais pas reçus en l’absence de l’enfant, ne voulant pas être dépositaire à son insu du secret. C’est parce que nous avons travaillé autour de cette énigme au travers d’histoires inventées, un peu analogues aux romans répétitifs de Modiano, qu’un jour de promenade en forêt, son oncle lui a avoué que son père, atteint du sida, était mort en prison, car il était dealer et usager d’héroïne.
L’important est de permettre à Minette de procéder à un travail de dépassement de ses tourments. Il est possible que l’on ne sache jamais ce qui s’est passé, cet aveu n’a pas à être recherché coûte que coûte, car on réitèrerait les confusions précédentes : ce qui compte maintenant est le chemin qu’elle doit accomplir. Pour ce faire, la proposition est de travailler dans le « mensonger prescrit », c’est-à-dire la fiction, pour arriver au « caché travesti » (en sémiotique, selon le « carré de la véridiction » de Greimas [Greimas A.-J., Courtès J., 1979], le mensonger correspond à la combinaison du paraître et du non-être, le caché [ou le secret] à la combinaison de l’être et du non-paraître. Ils peuvent constituer des bornes sur la route qui mène du faux qui conjugue non-paraître et non-être au vrai qui conjugue être et paraître).
La thérapie préférera au fantastique trop proche de notre réalité dans laquelle il peut faire irruption, notamment par les cauchemars et les fantasmes, le merveilleux sans connexion avec notre monde, selon la définition de Roger Caillois (1977). La proposition a juste ajouté une consigne à la continuité de la succession de ses productions existantes. Espérons qu’elle aidera Minette à enfin parcourir son chemin vers du plus vrai, la conduisant à être elle-même plus véridique…
Le passage par la fiction est ici plus opératoire que la recherche d’une « vérité objective » impossible à retrouver dans ce cas. L’objectif, pour l’heure, est moins de la découvrir que de permettre à l’enfant de mettre en création ce qu’il ne peut résoudre en direct. Ses inventions seront nourries de ses problématiques et elles en constituent une résolution sans même que nous parvenions toujours à bien comprendre ce dont il s’agit. La relation d’aide n’a plus été une quête cognitive en vue de conscientisation et de dévoilement de la véracité des actes allégués, mais un accompagnement de l’enfant dans une figuration énigmatique personnelle de ce qui l’aliène sous forme de symptômes répétitifs. Parfois, la distance libère, alors que l’investigation directe meurtrit de façon éventuellement irréversible. La vérité ne viendra, peut-être, qu’après tout ce travail.
Comme j’ai essayé de le démontrer dans un autre ouvrage qui est paru concomitamment au précédent (2006), la psychothérapie ne consiste pas seulement en une recherche sur l’origine des symboles que constituent les symptômes, les éléments des rêves, ou les signifiants des discours, elle est surtout un accompagnement de symbolisation.
« Quant à savoir comment traduire les symboles aux enfants, je dirai qu’en général, les enfants ont plus à nous apprendre dans ce domaine que l’inverse. Les symboles sont la langue même des enfants, nous n’avons pas à leur apprendre comment s’en servir. » (Ferenczi S., 1990.) ■
Note
* Entre autres F. Sironi, exposé dans le cycle organisé par le CIPIJ, 1994 ; Bourreaux et victimes, psychologie de la torture, Odile Jacob, 1999, Paris.
BibliographieCaillois R., 1977, Anthologie du fantastique, Gallimard, Paris. |