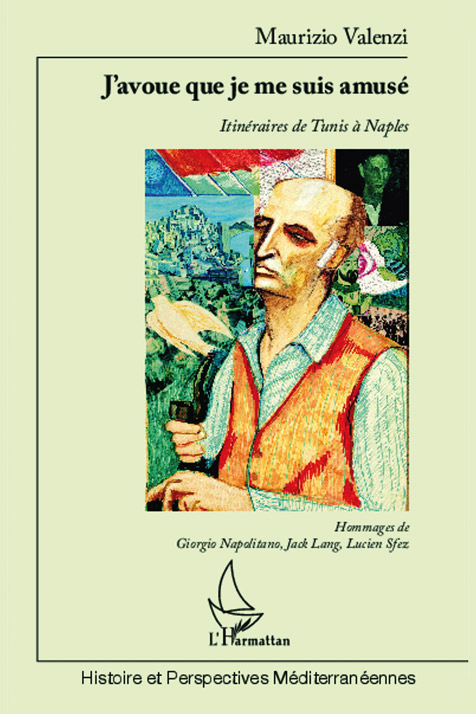Dossier : journal des psychologues n°253
Auteur(s) : Demailly André
Présentation
Ce texte intervient à un moment de la vie politique où il semble opportun de tirer quelques leçons des dernières élections présidentielles. En abordant le problème de la démarcation entre l’idéologie et la science politique, ou entre la théorie et les programmes ou dispositifs techniques, ou encore entre les démarches individuelles et les processus collectifs, l’auteur, qui s’exprime ici en tant que spécialiste des organisations, apporte une contribution psychosociale originale à l’analyse politique.
Mots Clés
Détail de l'article
Outre qu’elles mettent en concurrence les candidats les plus divers, les élections présidentielles sont la vitrine de quantités de corporations. D’un côté, la couverture des meetings et des débats demeure la chasse gardée des journalistes. De l’autre, des historiens et des politologues s’attachent à repérer les tendances lourdes et les inflexions subtiles des partis, tandis que des sociologues et des sondeurs s’ingénient à disséquer les intentions et les bulletins de vote de la population. Plus en sourdine, des experts en communication se plaisent à évaluer le comportement des candidats ou les désirs des électeurs, tandis que de doctes philosophes dissertent de l’évolution des idéologies en présence.
Pourtant, cette débauche de commentaires nous laisse sur notre faim, en nous donnant l’impression de ne pas aller à l’essentiel ou d’occulter certaines questions troublantes quant aux raisons de la rigidité et de l’immobilisme de tel ou tel parti ou de la ferveur quasi religieuse suscitée par telle candidate. Le psychologue peut se sentir encore plus frustré : d’un côté, il est frappé par le silence de ses pairs dans ce concert et peut se demander si l’« inaudibilité » de sa discipline est le fait de la société (médias, classe politique, enseignement) ou de ses propres ténors (inadéquation de leurs orientations de recherche ou d’intervention) ; de l’autre, il peut estimer qu’il aurait pu en dire plus et mieux sur ce sujet.
On examinera tout d’abord divers arguments épistémologiques qui sont souvent avancés pour justifier cette insatisfaction postélectorale. Ceux-ci opposent notamment :
• le temps court des commentaires à chaud au temps long des interprétations à froid ;
• l’idéologie (qui serait le propre de la politique) à la connaissance (qui serait l’apanage de la science) ;
• plus subtilement, les constructions théoriques, tant idéologiques que scientifiques, aux dispositifs plus opérationnels qui donnent davantage prise au verdict des faits ou du temps.
On verra alors que ces oppositions ne tiennent pas lorsqu’on les examine une par une, mais qu’il peut être très éclairant d’y jeter un regard psychosocial qui en relie les termes autrement.
Ainsi, tout parti tend à se constituer autour d’une idéologie plus ou moins malléable, mais aussi sur des dispositifs organisationnels qui le seront encore moins. Sa rigidité, son immobilisme apparent ou sa capacité de s’illusionner pourront être l’effet de l’une et-ou des autres. Mais il en va de même des disciplines scientifiques qui l’étudieront, tant en fonction des théories qu’elles privilégient que des démarches plus opérationnelles qu’elles adoptent. D’une manière plus générale, on tentera de montrer que cette dérive des partis et des disciplines vers les mêmes maux prend encore plus de relief si on l’examine sous l’angle de la ruse, considérée comme mode d’adaptation du vivant à son environnement.
Des oppositions épistémologiques
Dès lors qu’il s’interroge lui aussi sur les tenants et aboutissants de ses propres pratiques, le psychologue ne peut qu’être intéressé par les arguments qui tentent de percer le halo de mystère qui nimbe toute campagne électorale : le temps long ne serait-il pas plutôt celui de la science, et le temps court ne caractériserait-il pas davantage des élucubrations un peu plus folles ou des humeurs plus vagabondes ? Ou encore, la théorie ne serait-elle pas plutôt la source commune de l’idéologie et de la science, lesquelles ne se distingueraient ensuite que par le mode de mise à l’épreuve de leurs propositions ?
Temps court contre temps long
Sous cet angle, notre insatisfaction résulterait moins d’un déficit de compétence ou de talent des diverses corporations chargées de commenter la scène politique que d’un cahier des charges trop draconien qui les amènerait à en privilégier certains pans : les discours plus que les actes, les intentions ou les votes plus que leur dynamique profonde, le présent immédiat plus que le passé ou le futur. Autrement dit, ce cahier des charges privilégierait plus le rappel du familier que la recherche de l’incongru et davantage le déclenchement de réponses toutes prêtes que la formulation de questions plus pénétrantes.
On objectera à cela que les spécialistes de la politique ont eu tout le temps de réfléchir à ces questions ou d’en formuler de nouvelles, bien avant le démarrage de la campagne présidentielle. À leur décharge, on pourrait avancer que les propos les plus perspicaces ont été couverts par les plus opportunistes ou les plus hypnotiques. Ce qui suggérerait que ceux des uns seraient plus scientifiques et que ceux des autres seraient plus idéologiques…
Idéologie contre science
Ce clivage peut suggérer deux options très différentes. La première exclurait que les idéologies pussent avoir quelque fondement scientifique et que la science pût puiser utilement dans leur magma. De fait, tout au long du XXe siècle, on a vu s’effondrer tant les illusions d’une « science prolétarienne », fondant les totalitarismes révolutionnaires, que les rêves d’un libéralisme pur et dur, s’appuyant aveuglément sur une équilibration naturelle des marchés. Certes, « chat échaudé craint l’eau froide », mais cette option de nette démarcation implique aussi la perte de tout espoir de compréhension en profondeur des choix politiques et des décisions qu’ils entraînent ! Réciproquement, cela signifierait également que les choix scientifiques échapperaient à tout contrôle politique.
La seconde irait dans le sens d’une démarcation moins nette : d’un côté, on accepterait l’idée que la science pût puiser ses idées dans les valeurs ou les passions idéologiques et qu’inversement l’idéologie pût trouver quelques repères dans la science ; de l’autre, on s’inquiéterait tout de même de ce que la connaissance scientifique peinât tant à éclairer les phénomènes politiques. À cet égard, les Américains ont une longueur d’avance sur les Européens et surtout les Français. Dès 1863, à la suite de la bataille de Gettysburg, ils se sont aperçus qu’ils s’étaient entredéchirés au nom d’idées abstraites d’autant plus violentes qu’elles semblaient rationnelles ; à partir de là, ils ont décidé de faire passer l’utilité des idées avant leur rationalité (Rioux, 2006). Les Français ont connu des déchirements bien plus nombreux, mais ont continué d’imputer les malheurs des uns aux idées des autres. Les élections présidentielles américaines se font sur des programmes et des dispositifs précis, alors que la plupart des candidats français s’en tiennent encore à faire miroiter de grandes idées assorties de longs catalogues de promesses…
Théorie contre dispositif
Le clivage théorie/dispositif aurait donc l’avantage d’éviter une démarcation trop abrupte entre idéologie et science. D’un côté, cela reviendrait à dire que les théories se repaissent essentiellement de mots véhiculant des notions et concepts abstraits qui sont coupés d’une réalité constituée de bien d’autres signes, alors que les dispositifs seraient bien plus ancrés dans le réel. De l’autre, cela reviendrait à dire aussi que les théories sont irréfutables tant qu’elles n’ont pas été traduites en dispositifs qui puissent être soumis au verdict des faits. De prime abord, cette façon de voir « poppérienne » (Popper, 1972) est séduisante, quand on songe que la science a bien plus d’occasions de traduire ses théories en dispositifs sur lesquels elle puisse expérimenter à petite échelle et sans trop de risques, alors que la politique tourne à la catastrophe quand elle traduit et expérimente directement les siennes à grande échelle (si l’on songe aux millions de victimes qu’ont semées les élucubrations de Staline, Hitler, Mao ou Pol Pot).
En y regardant de plus près, on s’aperçoit cependant que ce clivage théorie/dispositif ne fonctionne pas du tout pour la science et les techniques : d’un côté, la gestation d’une théorie suit des voies tortueuses et souvent impénétrables où les images et les sensations internes se passent fort bien des mots ; de l’autre, les dispositifs techniques sont fréquemment évoqués en l’absence de toute théorie et même de tout besoin humain qu’ils viseraient à satisfaire. De ce point de vue, les théories idéologiques ont des origines bien plus transparentes (assurer la domination d’un groupe ou promouvoir celle d’un autre, par exemple), de même que les dispositifs et programmes politiques tendent le plus souvent à répondre à des besoins de la population ou à des insuffisances des dispositifs antérieurs.
Un regard plus psychosocial
En brouillant le paysage (démarcation floue de l’idéologie et de la science, dissociation de la théorie et du verbe, d’une part, ou des dispositifs et des réalités, d’autre part), ce regard épistémologique ouvre une série de brèches où les passions et illusions humaines peuvent s’insinuer à plaisir pour le meilleur ou pour le pire. En ce qui concerne la science, T. S Kuhn (1962) avance notamment que celle-ci, loin de progresser de manière cumulative par « découvertes » successives et « évidentes », est le lieu d’affrontements incessants de paradigmes (ou « manières de voir et de faire ») inconciliables, dont l’origine se perd dans le tréfonds des expériences collectives et individuelles. Pour lui, un paradigme ne meurt jamais définitivement, et il en naît constamment de nouveaux qui se nourrissent des anomalies et apories des précédents. Il souligne aussi qu’un paradigme momentanément dominant tend à devenir la « science normale » en imposant, de façon rigide, la manière de poser les problèmes et de leur trouver des solutions. En ce qui concerne la politique, cette idée d’affrontement incessant de paradigmes inconciliables choque beaucoup moins, mais laisse déjà entrevoir combien un paradigme dominant peut introduire de rigidité et d’œillères dans la perception de la réalité et les rapports humains.
Les psychologues et les psychosociologues sont plutôt bien placés pour saisir ces entrelacs. Se situant aux confins des sciences biologiques, psychologiques et sociologiques, ils sont amenés à relier les démarches individuelles et les processus collectifs. Mais ils peuvent se laisser prendre aussi dans les rets d’un paradigme dominant, être indifférents à d’autres manières de voir (surtout si elles viennent d’autres disciplines) ou être captivés par la magie du verbe. Ce faisant, ils peuvent être atteints des mêmes tares que ceux dont ils tentent d’expliquer les comportements, notamment dans le domaine politique.
On examinera donc quelques points saillants des récentes élections présidentielles où les errements des acteurs et de leurs observateurs s’entremêlent singulièrement. Le premier porte tant sur la rigidité de la direction de certains partis que sur celle de certaines grilles de lecture. Le deuxième porte tant sur l’engouement quasi religieux suscité par une candidate quasi mariale que sur sa résonance avec certaines propensions interprétatives. Le troisième porte tant sur l’immobilisme apparent des partis et des disciplines que sur son décryptage à la lumière de l’immense trésor analogique des ruses végétales et animales.
La rigidité des partis
Les dernières élections présidentielles ont confirmé la rigidité de certains partis, et notamment du parti socialiste, longtemps incapable de s’entendre sur le candidat qui le représenterait et d’autant plus démuni pour concevoir un véritable programme autour de celui-ci.
Comme on l’a déjà souligné, les psychologues ne se sont guère exprimés sur ce sujet ou l’ont soigneusement évité. S’ils avaient été contraints de le faire, nul doute que la plupart d’entre eux se seraient référés aux théories de la bureaucratie de M. Weber et de la sociologie institutionnelle qui mettent en avant des variables essentiellement psychosociales. M. Weber (1919) montre notamment que le modèle bureaucratique constitue un immense progrès par rapport au modèle patriarcal antérieur (fondé sur la naissance ou le charisme), en autorisant un fonctionnement collectif efficace, fondé sur des règles impersonnelles écrites et une hiérarchie des compétences. R. Michels (1911) souligne aussitôt que ce modèle favorise rapidement l’émergence d’une oligarchie plus soucieuse de ses intérêts que des masses qu’elle est censée servir. R. K. Merton (1936), P. Selznick (1949) et A. W. Gouldner (1954) montrent, par ailleurs, qu’une bureaucratie a tendance à se replier sur elle-même, à se ramifier en divers groupes qui défendent leurs intérêts particuliers ou à se satisfaire des comportements minimaux autorisés par le règlement (à chaque fois au mépris de ceux qu’elle doit servir). M. Crozier et E. Friedberg (1977) y ajoutent l’idée qu’une bureaucratie est incapable d’adaptations ponctuelles et que seule une crise générale, qui la touche dans son ensemble et de plein fouet, peut briser les multiples rigidités qui la paralysent.
De prime abord, ce modèle s’applique parfaitement à la direction du parti socialiste qui constitue une oligarchie incapable de s’ouvrir au monde extérieur et divisée en « tendances » qui ne semblent soucieuses que de leur propre intérêt. Mais sa version française et croziérienne tend à être soporifique, puisqu’elle invite tout un chacun à attendre langoureusement la fameuse crise qui transformera de fond en comble ce parti !
D’une certaine manière, les psychologues sont également victimes de ce schéma bureaucratique, puisqu’ils s’en remettent à une oligarchie qui enseigne ce genre de thèses et en ignore d’autres, notamment celles d’A. Giddens (1979) qui mettent en avant l’impact des initiatives individuelles et collectives sur les structures sociales et, par conséquent, la possibilité d’ajustements ponctuels de celles-ci.
Ils pourraient s’inspirer aussi de chercheurs qui, tel J. Diamond (2005), vont droit au but sans se préoccuper des frontières disciplinaires. Ornithologue de formation, celui-ci a parcouru les contrées les plus inhospitalières, s’est peu à peu intéressé aux hommes qui les peuplaient et s’est finalement interrogé sur les raisons de la disparition de certaines civilisations. Les résultats de son enquête sur l’effondrement de la société viking du Groenland (de 984 au début du XVe siècle) sont particulièrement impressionnants : 1) cette société restreinte (cinq mille âmes à son apogée) s’est acharnée à élever des vaches, des chèvres et des moutons (en ramassant du fourrage durant le court été pour le très long hiver) ; 2) en se privant, par manque de bois, de tout moyen de navigation et de pêche ; 3) en dédaignant d’apprendre des Inuits l’art de chasser le phoque et la baleine en toute saison. Selon la version officielle, elle se serait éteinte du fait de périodes de refroidissement qui auraient affecté ses ressources végétales et son cheptel animal. J. Diamond impute surtout cette extinction au maintien d’une organisation communautaire extrêmement hiérarchisée et rigide, soucieuse de maintenir un « mode de vie fictif » dans un environnement qui ne s’y prêtait pas.
À y regarder de plus près, les partis politiques lui ressemblent beaucoup. Dans une démocratie représentative, ils constituent des sortes de « colonie » ou de « sas », entre réalité et fiction, où se préparent les futurs représentants et dirigeants du pays. À la différence des Vikings du Groenland qui tentaient de maintenir un « mode de vie fictif » dans l’espace, ils sont enclins à créer un « mode de vie fictif » dans le temps : lorsqu’ils sont éloignés du pouvoir et de ses réalités, ils vivent plutôt dans un monde d’idées et de verbe ; lorsqu’ils reprennent la direction des affaires, ils sont plus pressés d’y appliquer leurs idées que d’en cerner les réalités. On peut penser que le parti socialiste a particulièrement souffert de ce mode de vie fictif, puisqu’il a été longtemps éloigné du pouvoir (les présidences de François Mitterrand et le passage de Lionel Jospin au gouvernement n’ayant pas suffi à prendre la pleine mesure des réalités du moment). On ajoutera que son mode d’organisation extrêmement centralisé et hiérarchisé a stérilisé toute initiative de la base et décuplé les bévues du sommet, à commencer par le mode de sélection de son candidat…
L’illusionnisme des partis
La comparaison des Vikings et des Inuits du Groenland nous permet d’opposer le mode de vie fictif des uns à la ruse des autres : les uns voulant commander à la nature, les autres ne cherchant qu’à s’y adapter en exploitant au mieux ses ressources. Elle nous permet surtout de donner la définition la plus large de la ruse comme art de composer, de manière aussi satisfaisante que possible, avec les situations et les événements, en utilisant tous les moyens du bord.
À l’instar des Vikings du Groenland, les psychologues et nombre de leurs collègues de sciences humaines nous semblent avoir sous-estimé l’importance de la ruse et surtout mal engagé son étude. Ils ont limité son champ aux rapports humains et en ont fait une démarche particulière de l’intelligence discursive. De fait, ils ont surtout étudié les processus heuristiques dans les situations les plus formelles, telles que le jeu d’échecs (Newell et Simon, 1972) ; et, s’ils se sont intéressés aux ruses des chercheurs, il s’agissait plus de la manière dont ceux-ci torpillaient leurs concurrents que des voies par lesquelles ils acquéraient leurs idées et données les plus pertinentes (Latour et Woolgar, 1979).
On nous objectera que la politique concerne au premier chef les rapports humains et se nourrit essentiellement de mots. Autrement dit, si la ruse s’y exerce, elle a trait à autrui et doit le faire avec des mots. On y répondra que c’est peut-être le cas des jeux électoraux, mais, qu’une fois aux affaires, les hommes politiques ont à gérer des réalités matérielles, économiques ou écologiques qui dépassent le cadre des hommes et des mots.
Dans cette perspective, les rapports du langage et de la ruse prennent un tour particulier. On oublie souvent que l’homme a longtemps été proie avant de devenir prédateur et qu’il a dû ruser pour s’imposer (en inventant les techniques ad hoc), bien avant de disposer de la parole et de l’écriture. Certes, le langage a ensuite décuplé ses capacités de réflexion et d’anticipation, en lui permettant de désigner des objets absents et de les relier, par la pensée, à quantité d’autres. Mais il a aussi eu l’effet contraire de n’en retenir que certains aspects (en le dissuadant d’explorer davantage les autres) et surtout d’hypostasier des illusions qui n’avaient aucune réalité. Autrement dit, le langage est aussi créateur de mythes et de chimères. Les religions monothéistes ont fait des prodiges en ce domaine non seulement en coupant la divinité de tout lien avec les éléments naturels (ce qui était le propre des religions polythéistes), mais en présentant celle-ci comme la source de messages transmis par les prophètes. Le christianisme a fait encore plus fort en distinguant en elle trois personnes et encore plus de relations particulières tant entre elles qu’entre chacune d’elles et le monde : le Père (inengendré) créant le monde et engendrant le Fils, tandis que l’Esprit Saint procède à la fois du Père et du Fils.
Les psychologues semblent avoir été particulièrement séduits par cette inventivité verbale. À propos de l’explication des désordres psychiques, G. Lantéri-Laura (1983) estime que le dogme trinitaire « fournirait le modèle originaire de toutes les topiques et de tous les systèmes qui s’efforcent de distinguer ce qu’ils unissent et d’unir ce qu’ils distinguent ». Ainsi, la psychose résulterait d’une procession à partir de deux hypostases, à savoir la forclusion et la désorganisation de la neurotransmission, tout comme le passage de l’explication œdipienne à celle du traumatisme prégénital se ferait sans problème.
Certes, G. Lantéri-Laura avait écrit son article dans le cadre d’un numéro spécial de la revue Génitif qui invitait de grands psychiatres de l’époque à présenter leurs vues sous forme de canular. Mais on est frappé par la résonance de sa thèse dans le champ tout aussi opaque de la vie politique et, tout particulièrement, des péripéties du parti socialiste lors des élections présidentielles. Les problèmes effectifs de la nation dans son environnement européen et mondial sont délaissés au profit de trois hypostases. La première aurait trait au Père et renverrait à « la gauche », qui prendrait un caractère d’infaillibilité, à moins que ce ne soit à la figure de François Mitterrand, qui revêtirait alors une allure d’éternité. La deuxième aurait trait au Fils engendré par le Père, à ceci près qu’il s’agirait ici d’une fille et d’une madone, qui appellerait aussitôt à ce que chacun la suive aveuglément, dès lors qu’elle ne peut trahir le Père et qu’elle est éclairée par le Saint-Esprit, troisième hypostase qui « procéderait » des deux précédentes. Laquelle pose d’ailleurs problème : d’un côté, il pourrait s’agir de la « doctrine du parti », à ceci près qu’elle n’est guère audible ; de l’autre, il s’agirait plutôt d’un « souffle » susceptible d’inspirer des mots nouveaux (« bravitude ») ou de « justes courroux » ou plus encore une « ferveur » quasi mystique des militants et électeurs.
Canular pour canular, cette interprétation du « phénomène Ségolène » vaut bien celle des « acrobaties psy ». On y voit que le modèle trinitaire défie l’entendement autant qu’il crée la communion, et combien certains instruments de la raison (les théories scientifiques ou les montages politiques) peuvent se retourner contre elle à la moindre occasion…
L’immobilisme des partis
En cédant moins aux vertiges du verbe, il est probable que les partis politiques auraient évité nombre de leurs maux. Il en va de même pour la psychologie et les sciences humaines, si elles s’étaient davantage ouvertes sur la pensée sans langage (Laplane, 2000) et l’ensemble des ruses du vivant.
Cette ouverture permet de constater que la ruse n’est pas une spécificité humaine : comment ne pas admirer les multiples mimétismes et stratagèmes à l’œuvre pour assurer la capacité reproductive des espèces, des populations et des individus ? Elle oblige surtout à reconnaître que cette ruse s’est déployée, au long de millions d’années, sur plusieurs axes : la prédation, le parasitisme, le commensalisme (ou parasitisme symbiotique) et l’altruisme. On retrouve ces axes chez l’homme et, plus encore, dans le domaine politique. Celui de la prédation y est omniprésent : il s’agit de prendre les voix de l’adversaire, de conquérir ses territoires ou de le « faire taire », même si on le fait au nom d’un commensalisme égalitaire ou d’un altruisme fraternel. Celui du parasitisme est moins souvent évoqué, alors qu’il s’épanouit à chaque élection : c’est pourquoi nous le privilégierons ici.
Rappelons d’abord son importance dans le domaine animal et végétal. Les virus et les bactéries ont toujours eu besoin d’un hôte pour se nourrir, se reproduire et voyager. D’innombrables plantes se branchent sur leurs voisines, plutôt que de puiser directement leur nourriture dans la terre. De nombreux insectes pondent leurs œufs sur d’autres animaux qui vont nourrir leurs larves. Les fourmis ont poussé encore plus loin ce raffinement en cultivant certains champignons dans des jardins aménagés ou en élevant un cheptel de pucerons dont elles consomment le miellat.
On soulignera l’originalité de la « théorie de la reine rouge » de L. Van Valen (1973 ; Workman et Reader, 2004) qui avance que les hôtes et leurs parasites sont entraînés dans une course sans fin, les uns en développant de nouvelles défenses contre les autres qui, quant à eux, adaptent de nouveaux moyens de les contourner, de sorte qu’ils en reviennent constamment à un statu quo qui n’est jamais le statu quo ante (autrement dit, en donnant l’impression que leurs rapports ne changent pas et font du « sur place », alors qu’ils évoluent sans cesse).
Le parasitisme est donc une forme particulièrement rusée de prédation, puisqu’elle épargne la proie tout en assurant la survie du prédateur. Le genre humain en a vite saisi l’intérêt, tant sur le plan interspécifique (élevage du bétail, culture des plantes) que sur le plan intraspécifique (exploitation des esclaves, des serfs ou des prisonniers politiques, sans autre compensation qu’un minimum de vivres et de couvert).
Les élections présidentielles ont été le théâtre d’un jeu encore plus subtil entre les divers partis de gauche et le parti socialiste. Ce dernier y revêt l’allure du grand prédateur qui doit « prendre » les voix des autres pour triompher de la droite. Parmi ceux-ci, le parti communiste, ex-grand prédateur, se présente comme un petit partenaire qui n’accepte d’être ingéré provisoirement qu’à la condition de contaminer durablement son hôte (en orientant son programme sur des voies égalitaires et partageuses). Mais le PC a lui aussi ses parasites, les partis trotskistes (LCR, Lutte ouvrière), qui n’ont de cesse de lui rappeler qu’il est révolutionnaire, même s’il n’y croit plus beaucoup. Autrement dit, on a une chaîne de parasites dont chaque maillon dirige le suivant sur des voies qui ne lui plaisent guère, mais qu’il doit faire semblant d’aimer.
La théorie de la reine rouge vient éclairer ce théâtre. Le citoyen lambda a l’impression qu’il ne s’y passe rien : l’immobilisme du parti socialiste français tranche avec le dynamisme de ses confrères européens. En fait, cet immobilisme apparent ne cesse de cacher de puissants mouvements internes : l’hôte tentant de se libérer de ses parasites et ceux-ci trouvant de nouvelles ruses pour s’y maintenir.
S’il y réfléchit bien, chaque psychologue s’aperçoit qu’il doit aussi « faire avec » ses propres parasites. Il y a d’abord ceux de la théorie qui le ramènent constamment vers les sentiers battus. Il y a ensuite ceux de la méthodologie qui lui rappellent les « seules » règles à suivre. Il y a aussi ceux de l’épistémologie, gardiens de la « bonne » manière de penser. Certes, il va tout faire pour s’en débarrasser et se sentir autonome, mais ils iront encore plus vite, quitte à retourner leur veste de temps à autre et à se présenter sous d’autres déguisements…
Conclusion
Avides de contes de fées, les enfants s’identifient immédiatement à leurs héros plutôt qu’à leurs personnages de second plan. Les adultes procèdent de même à propos d’autres histoires. Nos lecteurs se sont sans doute identifiés davantage aux Vikings du Groenland qu’à leurs voisins Inuits, à Ségolène ou à François plutôt qu’à certains de leurs collègues plus effacés, qui se sont pourtant davantage frottés aux affaires européennes ou mondiales. Mais, en définitive, ce sont bien ces derniers qui détiennent les véritables clés de la ruse, qui vont du respect des contraintes de l’environnement à la sélection d’actions qui préservent l’avenir, en passant par le refus de s’illusionner.
On voit là l’une des failles de notre société médiatique et l’une des limites des débats et commentaires qu’elle véhicule. Ceux-ci doivent avoir une rhétorique flamboyante qui séduise par quantité d’échafaudages, de promesses ou de rêves qui reviennent à commander aux choses plus qu’à les écouter. Paradoxalement, il est presque heureux que le psychologue n’y trouve pas tout à fait sa place : s’il travaille aussi avec des mots, il peut donner libre cours aux silences… qui constituent sans doute le premier pas de l’écoute de la réalité (le second consistant probablement à composer avec elle) !
BibliographieCrozier M., Friedberg E., 1977, L’Acteur et le système, Paris, Le Seuil. |