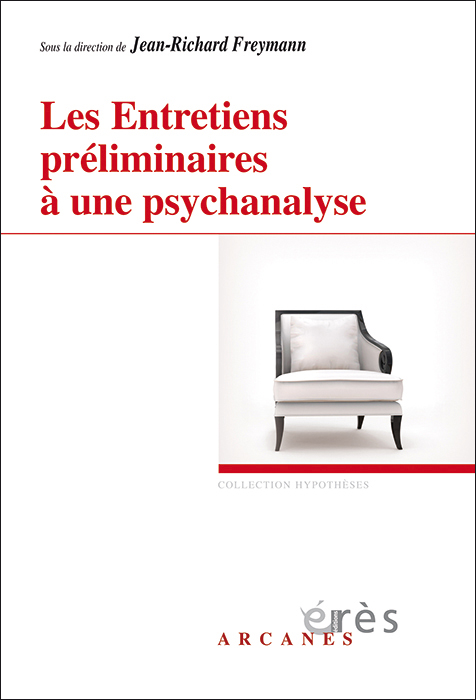Dossier : journal des psychologues n°257
Auteur(s) : Dalmasso Julian
Présentation
Ce travail critique prend comme base de réflexion un entretien clinique que Julian Dalmasso a réalisé en tant que stagiaire dans un service d’accueil des urgences. À travers l’évocation de diverses questions et difficultés auxquelles il s’est heurté lors de cette rencontre, il entend développer ici la question du regard dans l’entretien duel et ainsi rendre compte de la résonance dont il peut être le support. Il aborde d’une manière d’abord générale puis plus personnelle les difficultés de position éprouvées par un stagiaire en formation à travers une problématique identitaire.
Mots Clés
Détail de l'article
Annie, soixante-six ans, est adressée au service des urgences pour des chutes à répétition. Lors de notre rencontre, elle en est à sa troisième en seulement quatre jours. L’infirmière d’accueil fait part d’une certaine anxiété, ce qui motive alors ma démarche d’entretien.
Annie est une enseignante à la retraite, elle vit seule depuis le décès de son mari survenu cinq ans auparavant. Dès le début de l’entretien, elle me fait part de sa peur de rechuter, de se casser quelque chose. C’est seulement après avoir signifié son malaise qu’elle se présente : « Je suis la femme d’un avocat. » Elle me décrit alors son mari comme quelqu’un d’extraordinaire, d’important : « C’était un homme fabuleux. » Elle mentionne ensuite les nombreuses activités qu’elle pratiquait avec lui. Après cet épisode de remémoration empreint d’une certaine tristesse, elle me dit avoir un lien très fort avec un certain maître F., avocat, avec qui elle peut de nouveau entreprendre ses activités d’antan. J’apprends également qu’Annie n’aime pas le silence, elle le signifie d’ailleurs dès le premier silence de l’entretien. Néanmoins, le discours de la patiente, pourtant très logorrhéique jusqu’à présent, commence à s’estomper, ne laissant place qu’à quelques mots ou phrases témoignant de sa tristesse entrecoupés de silences de plus en plus longs. « Il me manque », dira-t-elle régulièrement. Annie, troublée, me fixe d’un regard de plus en plus figeant et commence à me poser, d’une façon très logorrhéique, un grand nombre de questions, sans pour autant me laisser le temps d’y répondre, me demandant alors si, personnellement, j’appréciais chacune des activités qu’elle pratiquait avec son mari ou encore avec maître F. : « Les restaurants, vous aimez ? », « Le golf, vous aimez ? vous y jouez ? », etc.
La patiente, qui provoqua alors mon mutisme par sa façon de m’interroger, me reprocha ce même comportement quelques instants plus tard en émettant l’injonction suivante : « J’aime qu’on réponde à mes questions ! »
Après cet épisode, Annie recommença son interrogatoire, m’expliquant qu’elle souhaitait parler de tout et de rien. Je lui proposais alors, par différentes interventions, de recentrer l’entretien sur cette anxiété qu’elle développait face aux conséquences d’une nouvelle chute – motif de notre rencontre –, mais Annie, par ses réponses approximatives, semblait véritablement vouloir centrer son discours sur, comme elle le disait elle-même, « tout et rien ».
Cet entretien, bien qu’il ne soit pas un modèle de richesse en matière d’éléments cliniques, a su me faire découvrir, d’une façon angoissante, le poids que peuvent avoir des éléments non verbaux lors d’un entretien duel, de face à face. La véritable difficulté présente tout au long de cet entretien fut le regard médusant que la patiente portait sur moi. À ce propos, la fonction sidérante que pouvait prendre ce regard m’empêchait de détourner, ne serait-ce qu’un court instant, mon propre regard du sien. À ce regard figeant s’est ajouté un discours, ces mots – « J’aime qu’on réponde à mes questions ! » – rendant le regard du même coup bien plus autoritaire encore. Une certaine autorité qui, pourrais-je dire, me plaçait alors dans une position d’élève, déstabilisé par une enseignante.
Il est possible de qualifier un aspect du transfert comme étant la place que le patient attribue à son analyste. Dans cette situation, bien que ce ne soit pas une analyse et que je ne sois pas analyste, je serais tenté de comprendre que la patiente m’attribuait alors un statut d’élève, son élève. De surcroît, ce statut d’élève était bel et bien le mien, même en dehors du contexte de cet entretien. De plus, quand nous sommes amenés, en tant que stagiaire, à rencontrer la souffrance d’un patient, il nous est demandé d’avoir une position, une posture professionnelle sans pour autant être en mesure de revendiquer une identité professionnelle, et ce, à juste titre, puisque, par définition, l’élève, c’est celui qui est en formation. La problématique du stagiaire pourrait être alors d’avoir pour ambition, à chaque entretien, de tenter de réduire cet hypothétique « écart », ce conflit entre sa position et son identité. Cependant, lors de cet entretien, le regard d’Annie, qui a fait résonner en moi mon statut d’élève, m’a déstabilisé, d’une part, par l’aspect médusant du regard lui-même et, d’autre part, en accentuant, par cette place qui m’était attribuée, cet écart que je m’efforçais de réduire. À ce titre, si l’on suit le référentiel théorique lacanien à propos du regard – qui avance que « l’autre est un miroir » –, il est possible que, dans cette situation, j’ai pu être déstabilisé en me voyant dans le regard de la patiente. Il serait intéressant d’entendre ce référentiel comme « ce que voit le sujet dans le regard de l’autre, c’est lui-même », et ainsi le transposer dans une dimension contre-transférentielle comme « ce que voit le clinicien dans le regard du patient, c’est [en partie] lui-même ». Le choix de préciser « en partie » a pour but de ne pas réduire le rôle du clinicien à ne voir que lui-même. Je prends conscience de ne pas dire cela de manière objective, mais il est de ma représentation de penser la fonction du clinicien à la fois sur ce qu’il voit de lui-même dans le regard du patient, mais également sur ce qu’il peut comprendre et, paradoxalement, entendre de cette mise en jeu du regard du patient. Il s’agirait ici de comprendre ce regard, à la fois comme une possible volonté de maîtrise de la part de la patiente, mais également comme un possible miroir de mon propre statut que je ne parvenais pas à assumer.
Cependant, que faire et que penser lorsque d’un entretien, on en ressort vidé ! La remise en question peut parfois paraître brutale, mais n’est-elle pas nécessaire ? Pourrait-on entreprendre d’aller jusqu’à dire que c’est une représentation trop « hollywoodienne » du psy et de son patient parfait qui vient de s’effondrer face au réel d’une confrontation, mais également à un partage de la souffrance. La rencontre idéale, celle d’un « soigner sans souffrir » s’éloigne pour laisser place à l’envahissement d’un ressenti, déstabilisant, mais peut-être preuve d’une étape nécessaire à une prise de conscience du travail à faire sur soi même pour soulager la souffrance d’un autre. Peut-être est-ce cela le mur auquel le stagiaire en formation se heurte ? Lui-même. Peut-être est-ce là l’effort à faire ? Se comprendre soi, par soi. En ce sens, une issue possible pourrait être de se permettre l’émergence d’une certaine spontanéité ; comme contenir un enfant dans ses bras lorsqu’il est en crise, par exemple, ou encore user d’ironie et d’humour afin de dissiper, pendant un cours instant, une souffrance, un grief, une colère… Après tout, il serait possible d’envisager l’hypothèse de l’émergence de son propre style à travers sa manière de gérer cette spontanéité. Cette spontanéité dont on pourrait se servir pour palier d’éventuelles carences au niveau théorique, et qui, bien qu’elle soit peut-être assimilée, peut tout à fait venir s’effacer face à cette souffrance d’un autre qui, quant à elle, ne s’apprend pas mais se vit et se partage lors d’une rencontre clinique. Cette spontanéité, ce style, certes « bancal » lorsqu’en tant que stagiaire l’heure est à la construction, l’élaboration d’une pratique, peuvent être vus également comme l’un des pas de côté possible face au technicisme, à la rectitude d’une théorie de la pratique. Ce pas de côté, cette prise de recul nécessaire pour affiner ce couple d’identités – stagiaire-universitaire – parfois si antinomiques mais qui s’avèrent tellement complémentaires.