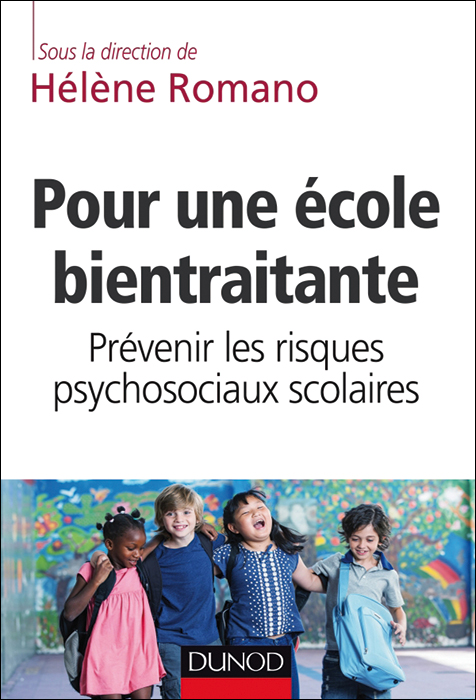Dossier : journal des psychologues n°245
Auteur(s) : Lecigne André
Présentation
André Lecigne propose d’élargir l’approche de l’échec scolaire au-delà de la « psychologisation » : son regard suggère de tenir compte de l’élève, de l’adulte, mais aussi de l’enjeu scolaire et de leur interaction dans la construction et la pérennisation de cet échec.
Mots Clés
Détail de l'article
Il est devenu banal en psychologie sociale de dire que les analyses des sciences sociales et psychologiques portent souvent en arrière-plan des conceptions idéologiques (voir Beauvois, 2005). Si ces conceptions sont rarement mises en avant, nous pouvons cependant en saisir quelques manifestations à l’école, notamment à travers la façon dont le monde enseignant explique les statuts scolaires des élèves. Notre propos concernera ici la grande majorité des élèves, et naturellement pas la petite proportion d’entre eux dont les difficultés éprouvées à l’école relèvent manifestement de troubles médico-psychologiques avérés, indépendants de l’école. Il faut en effet garder à l’esprit le caractère massif et social des difficultés scolaires. Chauveau (2005) nous rappelle que, dès le CP, 25 % des élèves sont en difficulté, ils sont jugés faibles, insuffisants ou mauvais, en particulier dans le domaine de la lecture-écriture. « Et environ 75 % de ces élèves, en difficulté dès la première année, appartiennent aux milieux socio-économiques les moins favorisés : au CP, 33 % des enfants d’ouvriers sont en échec en lecture contre 4 % des enfants de professeurs ou de cadres supérieurs » (p. 210).
Psychologisation et idéologie à l’école
Nous observons alors l’effet d’un processus particulier : « la psychologisation » (Leyens, 1983 ; Beauvois, 1984), qui revient à en appeler à des raisons psychologiques en fait et place de causes contextuelles, pour expliquer ce que font les gens ou ce qui leur arrive.
Les explications des performances des élèves
De nombreux travaux en milieu scolaire (par exemple Gosling, 1992 au collège, Lecigne et Castra, 1997 au primaire) montrent que les enseignants effectuent une véritable attribution de responsabilité aux élèves (équipement intellectuel, personnalité, motivations ; et dans certains cas via leur milieu familial) pour expliquer les statuts scolaires de ces derniers. Cette mise en avant de la responsabilité de l’élève renvoie à l’idée selon laquelle l’enfant porterait en quelque sorte en lui le programme de son développement (scolaire, social), cautionnant par moments la science génétique la plus orthodoxe. Bien que relevant d’une stricte erreur de jugement au regard du raisonnement scientifique (Ross, 1977, parlait d’ « erreur fondamentale »), cette surestimation de l’internalité fait écho dans nos sociétés à une norme sociale de jugement (dite « norme d’internalité », Jellisson et Green, 1981), qui a des effets paradoxaux : elle dessert l’exclu qui explique ses échecs par des caractéristiques personnelles (Castra, 1998), et valorise généralement les gens « bien » qui expriment de façon interne (leur motivation, leur personnalité, leur nature) plutôt qu’externe (l’environnement, les autres, le destin, le hasard, etc.) la causalité de leurs conduites ou de ce qui leur arrive (Dubois, 1994, 1998), y compris dans le champ éducatif (voir Calmettes, 2005, auprès d’une population de psychologues scolaires). Or, l’individu mis en avant par la valorisation de l’internalité n’est que la personne humaine vue à travers le prisme de l’individualisme (Luckes, 1973 ; Dumont, 1983). C’est ce qu’ont amplement montré des psychologues qui étudient les différences interculturelles (par exemple Triandis, 1989 ; Markus et Kitayama, 1991) : loin d’être universelle, la psychologisation apparaît historiquement datée et culturellement située au cœur des sociétés dites individualistes (notamment occidentales, en comparaison des sociétés dites collectivistes – Chine, Inde, etc.).
Nous allons voir maintenant que cette internalité peut varier au gré de certaines croyances des enseignants.
Justice du monde et inégalités scolaires
En préambule, appuyons-nous sur l’analyse des inégalités scolaires proposée par Duru-Bellat (2005). Pour elle, le rôle de l’école en France est aujourd’hui pensé sous le double modèle de « l’égalité des chances » et de la méritocratie. Intégrées ensemble, ces deux notions suggèrent que le système scolaire offre des chances égales à tous, dont les élèves pourront tirer parti selon leurs mérites. La seule égalité dans les faits est celle de l’accès pour tous à l’école. Pour le reste, et très vite dans la vie de l’écolier, se met en place un système concurrentiel où fonctionnent à plein des inégalités de toutes sortes (sociales, de motivation, de talent, etc.). Lorsque l’on sait que le pouvoir compensateur de l’école est bien faible (voir Duru-Bellat, 2002), la mise en avant des « aptitudes » des élèves les enchaîne irrémédiablement à leur destin et contredit dans la pratique les droits fondamentaux des élèves à l’éducation. Cette pseudo-égalité des chances cautionne de fait un processus de sélection quasi naturelle : des chances égales d’accéder, en fonction du « mérite », à des situations profondément inégales ; ou encore des chances égales de reproduire des situations inégalitaires. Sur un plan moral, Duru-Bellat pose alors une question redoutable à tout acteur de l’école : en quoi une sélection basée sur les caractéristiques ou les capacités des élèves serait juste ? Les différences entre les enfants peuvent-elles d’ailleurs fonder de justes inégalités ? Relevant d’une conception naturaliste du monde social, les différences des élèves pourraient ainsi offrir une justification à un accès inégal à l’enseignement, qui confond argument idéologique et explication scientifique.
Dès lors, comment comprendre la capacité des enseignants d’enseigner sur la base de discours égalitaires alors qu’ils vivent au quotidien dans ce monde scolaire fort élitiste ? Deux recherches nous offrent une hypothèse de réponse en nous éclairant sur l’existence et le fonctionnement de la croyance en un monde juste – CMJ – (Lerner, 1965, 1980, 1985) chez les enseignants du primaire : si tout le monde s’accorde sur le principe selon lequel l’instruction ne se mérite pas, que c’est un droit fondamental, la CMJ fait écho à l’idée simple particulièrement conservatrice que chacun occuperait à l’école et dans la société la place que ses « capacités intellectuelles » lui ont permis d’obtenir (1). La première étude (Vauzelle, 1999) a permis de montrer que plus les maîtres pensent que le monde est juste, plus ils estiment que l’élève est responsable du fait qu’il redouble sa classe. La seconde (Pierre, 2001), centrée sur le signalement des élèves au réseau d’aides spécialisées, a mis en évidence que plus les maîtres croient que le monde scolaire est juste, plus ils attribuent les raisons du signalement à l’enfant lui-même, et moins ils signalent d’élèves dans leur pratique, suivant une logique relativement fataliste : à quoi bon signaler un élève si tout est joué d’avance ?
L’adoption de telles croyances permet de maintenir le système en place, car elles donnent la possibilité à ce dernier d’être perçu comme juste, légitime, voire inévitable. Nous avons là un outil terriblement efficace de résignation collective, qui laisse place aux rapports de forces les plus brutaux, et agit comme un puissant facteur de stabilisation sociale et de maintien de l’ordre établi (2) (voir Bellon et Robert, 2001). En référant aux attitudes et valeurs qui octroient une justification à la hiérarchie sociale, l’on comprend combien la CMJ masque les rapports sociaux de domination et cautionne le discours de l’institution scolaire autour de l’individualisation des parcours (voir Merle, 2005). Ces représentations peuvent parfois se trouver à leur tour renforcées par un discours psychologique qui définit son objet comme étant l’individu singulier, unique, qui s’autoconstruit et qui porte en lui les déterminants de ses conduites. L’invention d’une psychologie trop exclusivement « intrapsychique » correspondrait à la forme la plus achevée de la CMJ au sein de la philosophie libérale. Rouquette (2001, p. 84) qualifie cruellement cette psychologie, qui transforme l’illusion individualiste en modèle scientifique, de « science pratique des fictions individualistes ».
Perspectives en psychologie scolaire
Une particularité du regard psychosocial réside dans le fait que l’interaction ne se réduit pas à un face-à-face singulier entre deux individus : les personnes entrent en interaction par rapport à un objet commun qui a valeur d’enjeu (compétition, évaluation...).
Quel rapport psychologue – élève ?
Si l’on suit le raisonnement de Beauvois (2005), les élèves ne sont pas des « objets » à observer, des « objets » de connaissance à proprement parler, mais des « objets » d’évaluation définis par les conduites et performances scolaires qu’ils sont censés réaliser. Le savoir produit n’implique donc pas seulement deux entités, l’adulte qui connaît et l’élève à connaître dans sa nature propre, il est le produit de l’interaction entre trois éléments : un adulte, un enjeu scolaire, un élève. C’est pourquoi les discours que l’on tient sur les élèves ne sont généralement pas faits pour connaître ce qu’ils sont véritablement, mais ce qu’ils « valent » dans l’arbitraire scolaire ; leur but est de nous aider à savoir comment nous comporter avec eux, à décider ce qu’on pourra bien faire d’eux... On le voit, cette connaissance n’est pas construite pour être scientifiquement vraie, mais pour coller à l’existence sociale et faciliter les prises de décision, suivant des critères fondés davantage sur une logique d’action que sur une logique de connaissance (voir Beauvois, 1994). Parce qu’il n’est pas certain que l’on sache toujours faire la part des deux, le risque devient alors important de se placer dans une posture où la conclusion précède la démonstration, et qui vient alors opportunément combler le manque de propositions crédibles dans le champ pédagogique ou politique. Ainsi n’a-t-on pas souvent tendance à prétendre décrire la nature la plus profonde des enfants tout en constatant dans la plupart des cas que cette nature correspond peu ou prou à ce que l’on attend des élèves dans les positions qu’ils occupent dans leur vie scolaire ? Dès lors, nos discours savants sur l’enfant ne risquent-ils pas de passer pour une paraphrase psychologisante de l’arbitraire scolaire ?
Parce que l’état des prévisions psychologiques demeure généralement insuffisant pour expliquer les situations scolaires complexes des élèves et pour envisager leur dénouement, ne conviendrait-il pas de rappeler à la psychologie scolaire qu’elle ne peut clore elle-même l’espace qui la fonde, tant son existence est intimement liée aux problèmes concrets rencontrés dans la vie de l’école ? Au-delà d’une réflexion indispensable sur la portée et les limites de notre discipline, on touche sans doute aussi à la notion de « pouvoir » des sciences humaines et de la psychologie en particulier, sciences qui, comme le souligne Chabrol (2004), « semblent demeurer d’abord un moyen d’observation des gouvernés, des consommateurs, des clients, des classes populaires, des classes d’âge extrêmes (jeunes ou vieux), des minorités ethniques ou politiques, et des malades mentaux » (p. 139), le tout dans un fonctionnement relativement opaque vis-à-vis de leurs prises de décision et d’évaluation d’autrui.
Un questionnement articulant plusieurs niveaux d’analyse
Doit-on attendre d’une psychologie qu’elle valide, même avec une certaine esthétique, les découpages de la réalité et de ses objets d’étude en domaines issus des représentations ordinaires ? Rien n’oblige le psychologue scolaire à entériner les pratiques dominantes, il est parfaitement légitime d’être psychologue à l’école en envisageant cette dernière comme un opérateur non neutre dans le processus d’enseignement. D’un point de vue scientifique, les effets de la variable « école » ne peuvent pas se réduire à ceux d’une toile de fond sur laquelle les élèves façonnent leur individualité. Comme le précise Carle (2005), le psychologue scolaire ne peut pas se cantonner dans un rôle de maintenance d’un système excluant. En questionnant les consensus, il doit aussi se positionner comme un agent de changement, cela nécessite notamment de ne pas se confiner dans la mesure, de ne pas se définir uniquement comme spécialiste de la pathologie des autres, mais de se donner les moyens d’avoir un rôle actif dans le jeu complexe des interactions. Si nous partons de l’idée que l’échec scolaire n’est pas un phénomène naturel, mais qu’il relève davantage d’une construction qui nécessite la « coopération » d’un grand nombre d’acteurs, nous pensons qu’il faut en saisir le processus d’élaboration et de pérennisation à l’articulation de différents niveaux d’analyse (suivant l’opérationnalisation de Doise, 1982) :
• intrapsychique, avec l’étude de l’influence des variables cognitives (avec le sens de l’activité d’apprentissage) et affectives ;
•l interpersonnel et groupal, avec la prise en compte des modalités réelles de l’activité d’enseignement et des activités intermédiaires, des caractéristiques de la relation pédagogique, du développement d’attitudes et d’attentes spécifiques, des mécanismes de stigmatisation et de mise à l’écart, de mise en conformité de l’élève aux attentes dont il est l’objet ;
• positionnel, avec le jeu des positions sociales, statuts, rôles et relations des acteurs de l’action éducative, des liens entre monde de l’école et monde de la maison ;
• idéologique, avec le questionnement des points de vue, des manières de voir le monde, qui se cachent derrière les pratiques scolaires, des stratégies, jugements et représentations des différents acteurs.
Bien que ces quatre « points de vue » soient en constante interaction, il appartient au psychologue d’apprécier de manière précise le poids respectif des diverses variables impliquées à chacun d’entre eux. Ce travail difficile et nécessaire vient souligner combien la psychologie dans l’école implique la mise en œuvre de savoirs qui ne doivent pas se laisser enfermer dans les applications pratiques de telle ou telle sous-discipline de la psychologie. Confrontée à des enjeux humains, l’activité des psychologues à l’école doit, selon nous, fournir des hypothèses de travail à une véritable posture de recherche-action, où l’évaluation rigoureuse et permanente des effets de l’intervention psycho-socio-éducative est mise au service de l’ajustement des méthodes et des savoirs. En effet, le psychologue à l’école est-il a priori capable de résoudre tous les problèmes qu’il se pose ? Est-il à la hauteur de ses ambitions de maîtrise ? Répondre affirmativement, c’est lui reconnaître une force supra humaine, hypothèse qui, d’ordinaire, heurte les scientifiques. Répondre par la négative, ou au moins par le doute, c’est peut-être se donner de nouvelles chances d’agir avec précaution, par humilité et dans le souci du bien public. Cette optique suppose une certaine confiance dans l’idée de « réformabilité » d’un système seulement conçu comme « le moins mauvais possible » au vu des circonstances, parce que le plus adapté provisoirement à la « réalité », mais dont on devrait inlassablement tenter d’améliorer la rationalité et la justice. ■
Notes
1. Voir Lecigne et Castra, 2003.
2. Nous percevons ici la limite du concept de « fin des idéologies ». Il participe de la stigmatisation de tout ce qui n’est qu’« idéologique », donc passéiste, tout en donnant à penser d’autre part que notre école, et ce qui s’y fait, ne relève pas d’idéologie, mais du « bon sens », du « professionnalisme », ou pis de « l’intérêt » de l’enfant.
BibliographieBeauvois J.-L., 1984, La Psychologie quotidienne, Paris, Presses universitaires de France. |