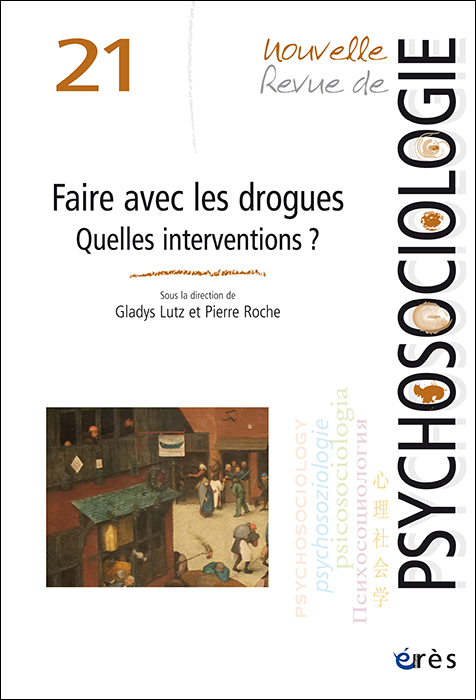Dossier : journal des psychologues n°242
Auteur(s) : Meunier Emmanuel
Présentation
Longtemps avant la psychanalyse, les hommes avaient coutume d’explorer la psyché, qui demeurait une terra incognita dont l’artiste était, par élection, l’explorateur attitré. L’usage de la drogue, pour certains d’entre eux (tels Gauthier, Nerval, Baudelaire, Jarry et bien d’autres encore), fut un moyen, plus ou moins ludique, d’en découvrir quelques ressorts cachés. Leur ambition était moins de comprendre le fonctionnement de la psyché que de révéler de nouvelles potentialités créatrices.
L’avènement de la psychanalyse va déqualifier, voire ramener au rang de puérilité, la prétention du poète à découvrir quelques secrets de la psyché en expérimentant les drogues. Dans ce second article, nous découvrirons l’usage du haschich que firent quelques auteurs du XXe siècle, en l’occurrence A. Breton, W. Benjamin et H. Michaux.
Isam Idris Psychologue, Responsable de rubrique pour Le Journal des psychologues
Mots Clés
Détail de l'article
Freud, l’art et les artistes
Freud rendit ainsi hommage aux artistes ; ils sont, écrit-il, « dans la connaissance de l’âme, nos maîtres à nous, hommes vulgaires, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas encore rendues accessibles à la science ». Hommage qui vaut oraison funèbre, car ce conquistador de la psyché qu’est Freud n’appartient pas aux « hommes vulgaires », qui confondent âme et psyché. Les poètes adoptent une attitude non moins ambivalente vis-à-vis de la psychanalyse : André Breton revendique avoir lu Freud, dès 1917 (avant qu’il ne soit traduit en français), à Saint-Dizier, quand il était interne dans un hôpital militaire ; mais il ne manque pas de produire un compte-rendu, de son propre aveu, « dépréciatif » de sa rencontre de 1922 avec le fondateur de la psychanalyse et il engage la polémique après la parution de Les Vases communicants (1932). Henri Michaux, un temps étudiant en médecine, étudiera lui aussi la psychanalyse et, dès 1924, il annonce son programme : montrer grâce au jeu, au rêve, à la folie et aux drogues, une psyché, dont Freud n’aurait dévoilé qu’une « petite partie ». Michaux, jeune homme qui a fait le Napo (un affluent de l’Amazone), délaisse les comptoirs où se seraient installés les psychanalystes, afin d’explorer l’immensité. Relation ambivalente, de part et d’autre, la psychanalyse déqualifiant les prétentions du poète, tout en tremblant, tel Lacan (un temps affilié au groupe surréaliste), devant la perspective de laisser la psychanalyse se confondre avec le « discours du Maître ».
Citer, ici, André Breton étonnera peut-être. En effet, Breton confesse n’avoir consommé qu’une seule fois du haschich, expérience sans lendemain, vécue en 1927 en compagnie de Jacques Prévert. L’usage des drogues n’entra jamais dans les mœurs surréalistes et, sans doute, ce groupe était-il trop « révolutionnaire » pour ne pas répugner devant cette pratique, trop « bourgeoise » et « décadente ». On trouve cependant dans Les Vases communicants la narration d’un usage du haschich, un récit absolument surréaliste, car il s’agit d’un usage au cours d’un… rêve.
Le haschich, le rêve et la réalité
Dans la nuit du 5 avril 1931, Breton rêve qu’il consomme du haschich. Accompagné d’un ami, il cherche sur un bord de mer (près de Lorient, où demeurent ses parents) un château où il sait pouvoir trouver du haschich. Marchant dans l’eau, il aperçoit un poisson merveilleux qu’il tente de poursuivre. Le poisson se transforme en une « femme oiseau », une furie qui lui jette une pierre avec une telle violence qu’il s’enfuit. Parvenu au château, au milieu de convives, il se fait servir de la pâte de haschich qu’il étale sur des petits pains ronds. Inquiétude, car le goût lui paraît étrange ; l’ironie des serveurs n’est pas pour le rassurer. Rupture : le voici d’un coup dans sa chambre. Il aperçoit deux petites filles nues (deux et six ans) qui jouent dans un coin. Il ne se laisse pas tromper : il s’agit de petites filles « hallucinatoires » – ce qui est bien naturel puisqu’il vient de consommer du haschich. Elles sont, d’ailleurs, très nettement « hallucinatoires », puisque leurs corps sont instables, mouvants, tendant à s’absorber l’un l’autre pour former un seul bloc. Il demande aux fillettes d’approcher, ce qu’elles font, et il lui vient l’idée de tenter de les toucher. Ébahi, Breton constate que l’on peut toucher une hallucination ! Eluard, aussi soudainement qu’opportunément apparu dans la chambre, est là pour entendre tout ce que disait Breton sur cette incroyable découverte. Puis cette impression désagréable : une des petites filles vient de pisser. Le père de Breton entre dans la chambre. Les petites filles (et Eluard avec) disparaissent. La mère de Breton entre à son tour. Elle est atterrée que son fils ait pu souiller d’urine l’ameublement, forfait qu’il avait déjà accompli, mais c’était il y a fort longtemps. Breton renonce à accuser les petites filles, car il n’y a pas de vraisemblance à accuser des petites filles « hallucinatoires ». Les parents partis, les deux fillettes sont de retour : « Elles prennent vite une intensité terrifiante. Je sens que je deviens fou. Je demande qu’on allume. Personne ne m’entend. » Le rêve du haschich tourne au cauchemar.
Ce récit de rêve, curieux à souhait, trouve son intérêt littéraire à être inséré dans une relation des quinze journées de la vie d’André Breton qui succédèrent à ce rêve. Breton a fait ce rêve à la suite d’une rupture sentimentale, qui l’a ébranlé. Le 30 mars, le divorce d’André et de Simone Breton a été prononcé. La femme oiseau lanceuse de pierre a peut-être des liens avec cet événement. Quoi qu’il en soit, durant les quinze jours consécutifs à ce rêve, Breton perd le contrôle de son existence. Errant à travers Paris, il se décrit tombant éperdument amoureux de trois femmes, successivement, trois femmes passantes qu’il se voit prêt à épouser sur-le-champ. Exalté, il opère des liens entre des menus faits sans rapports aucun, les rapproche comme le ferait un détective en quête d’indices, et entrevoit des « grandes vérités » au moins improbables. « J’étais tenté de croire que les choses de la vie […] ne s’organisaient ainsi que pour moi. Ce qui se produisait […] me paraissait m’être dû. J’y trouvais des indications, j’y cherchais des promesses. Ceux qui se seront trouvés dans une situation analogue ne m’en voudront pas. De ce rêve éveillé, traînant sur plusieurs jours, le contenu manifeste était, à première vue, à peine plus explicite que celui d’un rêve endormi. »
L’intérêt du récit de Breton tient à cette communauté d’atmosphère entre un rêve (où le rêveur enquête sur son hallucination jusqu’à ce que le cauchemar suscite l’éveil) et une vie d’éveillé (où le veilleur confine au délire.) L’honnêteté foncière de Breton est d’exposer ces faits de manière exhaustive et sans interprétation hâtive. Il est factuel, à la manière d’un médecin qui rédigerait un cas clinique relatif à une pathologie encore indéterminée. Il n’écrit pas : mon rêve a déclenché, dans ma vie, un épisode « délirant » ; il n’affirme pas non plus : mon rêve a pressenti et annoncé un épisode délirant, qui « couvait » en quelque manière ; ni ne prétend que la réminiscence d’une expérience de prise de haschich ait un lien avec ce contexte délirant, le cannabis pouvant produire chez certaines personnes un état d’angoisse et un sentiment de menace sur l’équilibre psychique, ce qui les empêche bien souvent de renouveler l’expérience. Sa seule certitude, qu’il livre en conclusion de son livre, c’est qu’il existe « un tissu capillaire » qui assure un échange constant « entre le monde intérieur et le monde extérieur, échange qui nécessite l’interpénétration continue de l’activité de veille et l’activité de sommeil ». Conviction d’une unité de l’Homme et d’un impératif pour l’art de transcender les clivages entre rêve et veille, entre normal et pathologique, conviction qui est au cœur du projet surréaliste.
Walter Benjamin ne bénéficie pas d’une notoriété égale à celle de Breton et Michaux, aussi convient-il de rappeler quelques traits de son œuvre. Écrivain et sociologue allemand, juif, antifasciste exilé en France à partir de 1933, Benjamin se suicide par surdose de morphine en 1940 afin d’échapper à une arrestation imminente. Il laisse une œuvre inachevée qui sera redécouverte plus tard. Avant d’examiner une nouvelle sur le haschich et des carnets de notes qu’il rédigea sous l’emprise du haschich ou juste après ses consommations, rappelons quelques-unes de ses préoccupations telles qu’elles apparaissent dans son livre Paris, capitale du XIXe siècle, ouvrage resté en chantier. Walter Benjamin peut être défini comme un continuateur des romantiques, convaincus que la modernité capitaliste désacralise le monde, et un précurseur de Guy Debord et de sa « société du spectacle ». W. Benjamin part du constat que le capitalisme tend à réduire les rapports sociaux à des rapports d’échange fondés sur l’intérêt, ce qui induit au plan culturel la perte « d’aura » des anciennes figures telles que les « saints », les « savants », les « grands hommes », les « héros », etc. « Au temps d’Homère, écrit-il, l’Humanité s’offrait en spectacle aux dieux de l’Olympe ; c’est à elle-même qu’elle s’offre aujourd’hui, en spectacle. » Dans son livre sur Paris, il montre comment l’ordre marchand va recomposer l’espace social et urbain autour d’un être nouveau, détenteur d’une « aura » moderne : cet être c’est le « flâneur ». Le flâneur est un homme ou une femme qui déambule, guidé par le spectacle des marchandises exposées, mais qui s’offre, en même temps, au regard des autres. W. Benjamin montre que la ville s’organise, au long du XIXe siècle, pour contenter ce flâneur. Retraçant l’histoire de l’espace urbain, il remonte à l’invention des « passages » (galerie marchande couverte), pour voir apparaître les trottoirs et le développement des devantures de magasins, puis (les marchandises devenant internationales et coloniales) l’apparition des « trottoirs et escaliers mécaniques » qui permettent de visiter les expositions universelles et coloniales. En tous ces lieux, le flâneur trouve à se montrer : s’invente alors des terrasses de café, l’industrie se structure pour organiser le renouvellement constant des modes vestimentaires, etc. Walter Benjamin remarque aussi la puissance anxiogène de la modernité, et il montre que le capitalisme, par sa puissance mystificatrice, puise dans la nostalgie des temps anciens pour apaiser l’anxiété. Ainsi, l’invention du métro (qui va, pour la première fois, organiser une circulation de masse par les entrailles de la terre) sera-
t-elle accompagnée par l’architecte Guimard et son « art nouveau », tellement végétal. Les fleurs d’acier des bouches de métro rappellent inconsciemment Perséphone, qui descend aux enfers mais pour revenir sur terre, au printemps, afin d’accompagner la pousse végétale. Au cours de son travail sur le Paris du XIXe, Benjamin découvre aussi, et avec enthousiasme, Baudelaire, l’auteur de Le Spleen de Paris et de Les Paradis artificiels.
La « sociologie » de W. Benjamin veut penser la réalité à l’intérieur d’une dynamique où le psychisme et le social interagissent constamment. Son expérimentation du haschich s’inscrit dans une enquête sur le fonctionnement de la psyché. Il nous a laissé des notes de ces expériences du haschich, qui s’étalent entre 1927 et 1931 (Bourgois, 2001). Il ingérait le haschich disponible alors, en « préparation pharmaceutique ». L’usage du haschich va lui permettre de mieux saisir le concept d’« aura », ou plutôt de le saisir, comme une expérience intime, intérieure. Car son concept d’« aura » n’est ni sociologique (comme l’est le concept de « réputation » ou de « prestige ») ni psychologique, comme l’est le concept de « narcissisme » ou d’« exhibitionnisme » : c’est un concept psychosocial.
À propos du haschich, il note que le consommateur n’est pas hors du monde, comme l’est l’utilisateur d’une drogue de « défonce ». Son appréhension du monde extérieur est ambivalente. Il éprouve, sans doute, une « répugnance marquée à (s)’entretenir des choses de la vie pratique, de l’avenir, des dates, de politique ». « La pensée du “dehors” devient presque une torture », écrit-il, pour rendre compte du désintérêt absolu pour l’aspect concret de l’existence. Ce retrait relatif du monde est lié au fait que si le hachichin veut laisser émerger en lui-même des « images » mentales et des rêveries, il doit s’interdire de polariser son attention sur la réalité concrète. « La production d’image, note-t-il, peut faire venir au jour des choses si extraordinaires et cela si fugitivement et avec une telle vitesse que nous ne parvenons plus, tout simplement en raison de la beauté et de la singularité de ces images, à nous intéresser à autre chose qu’à elles. » Le retrait de la réalité n’est en fait que relatif, car c’est la réalité qui fournit les motifs qui suscitent les images intérieures et les rêveries.
Le sentiment de « l’aura » est une expérience du hachichin : de même que le flâneur se délecte du spectacle des marchandises, le hachichin savoure le monde en tant qu’il stimule son activité rêveuse : le monde semble lui adresser, écrit-il, des « clins d’œil venus du nirvana ». W. Benjamin constate « la simultanéité maléfique du besoin d’être seul et de demeurer avec les autres. On a le sentiment de ne pouvoir se laisser prendre par ce clignement ambigu venu du nirvana que tout à fait solitaire et dans le calme le plus profond. On a besoin de la présence des autres comme figures en relief glissant silencieusement sur le socle de son propre trône ». L’autre est nécessaire pour être pris à témoin de l’extraordinaire qui nous arrive, pour écouter les vives pensées qui naissent au contact des impressions ressenties. Mais le hachichin ne concèdera pas de meilleure place à l’autre. En témoigne sa difficulté à suivre les conversations des autres. Difficulté insurmontable, car « à peine le partenaire a-t-il ouvert la bouche qu’il nous déçoit. […] Il nous déçoit douloureusement en s’écartant du plus grand objet de toute attention : nous-mêmes ». Drogue d’auto-affection, donc, qui confère au hachichin cette posture de « roi méconnu des passants », formulée par Baudelaire. W. Benjamin raconte : « J’ai tenu à la main le verre rempli de café un bon quart d’heure, si ce n’est plus, sans bouger, j’expliquais qu’il était indigne de moi d’en boire, le métamorphosais d’une certaine façon en sceptre. Car on peut bien parler, dans le haschich, d’un besoin de sceptre éprouvé par la main. »
W. Benjamin s’interroge sur ce produit qui engendre tantôt l’anxiété et qui tantôt semble anxiolytique. Une nouvelle de Benjamin, intitulée Myslowice – Braunschweig – Marseille (1935), raconte l’errance d’un homme, sous l’emprise du haschich, sur le port de Marseille. Le récit est directement inspiré d’une expérience vécue, relatée dans ses carnets de notes. Il y raconte comment cette propension à faire naître des images intérieures permet de conjurer l’anxiété, un peu comme l’architecture « végétale » de Guimard venait conjurer l’angoisse des premiers utilisateurs du métro. Entré dans un bar plutôt mal famé, le narrateur observe que le haschich développe l’acuité de son regard : « Je dévorais littéralement des yeux les visages qui m’entouraient et que j’aurais évités à tout autre moment pour deux raisons : parce que je n’aurais pas souhaité attirer l’attention sur moi, et parce que je n’aurais pas supporté leur brutalité. Je comprenais soudain comment un peintre – ne fut-ce pas le cas de Léonard et de bien d’autres ? – peut trouver dans le laid le véritable réservoir du beau, mieux : son trésor. » L’activité psychique permet d’associer des œuvres à des visages ravagés ; puis le narrateur se livre à un jeu : imaginer que chacune des personnes qui l’entourent est une « connaissance » ; et, aussitôt, il trouve, pour chaque visage, un nom familier qui leur correspond à ravir. Cette propension du haschich à stimuler la sublimation et le jeu est probablement l’une des clés qui permet de comprendre les vertus « apaisantes » de ce produit.
Lecteur de Freud, W. Benjamin développera le concept « d’inconscient optique » pour rendre compte de ces objets de recherche : la question de l’aura, mais aussi celle de « l’esthétisation » du politique par les fascistes. Le cannabis est aussi une drogue qui permet (sauf chez des individus peu structurés) de contrôler un mouvement de passage de l’état de rêverie à l’état de veille normal, puis de l’état normal à celui de la rêverie. Lui-même tentait de penser dans un espace intermédiaire, en cherchant des voies de passage qui unissent le psychique et le social.
Henri Michaux expérimenta nombre de drogues hallucinogènes (principalement entre 1956 et 1961) et, tout particulièrement, la mescaline (extraite du peyotl), la psilocybine et le LSD. Il rapporte ses expériences, notamment, dans Misérables miracles (1956) et Connaissance par les gouffres (1961). Le cannabis fut, de toutes les drogues, celle qu’il consomma le plus. Car c’est une drogue assez commode, sans rapport avec les autres hallucinogènes qu’il expérimenta avec l’assistance d’amis psychiatres, tels Henry Ey ou Jean Delay. Du cannabis, il voudrait nous en parler comme d’une drogue « étalon », une drogue qui permet de mieux cerner l’action des autres hallucinogènes. Il note : « Celui qui, comme expérience témoin, prendra du haschich après la mescaline quitte une auto de course pour un poney. » Cependant, il convient qu’un « poney peut toutefois donner des surprises qu’il ne faudrait pas attendre d’une locomotive ». Il consent à nous faire part de quelques spécificités du haschich, en observant qu’il suscite une « tendance aux mouvements, à “mettre en mouvement” ».
Michaux qualifie les opérations mentales du hachichin de productions d’une pensée « néoténique » (qui tend après) : « Avant qu’une pensée ne soit accomplie, venue à maturité, elle accouche d’une nouvelle, et celle-ci à peine née, incomplètement formée, en met au monde une autre… » Tension de la pensée qui s’exprime aussi par une tendance du hachichin à créer des mots-valises et à former des néologismes. Cette tendance au mouvement s’exprime aussi par les impressions de désorientation (assez semblable à celle que l’on éprouve dans les trains à l’arrêt, mais où l’on croit se déplacer, à cause d’un autre qui arrive en gare), ainsi que les impressions de « soulèvement du corps ». Impression aérienne qui conduit Michaux à se demander si les premiers nomades de Perse et d’Arabie ne doivent pas au haschich l’invention des tapis volants ! Le mouvement de la pensée « néoténique » n’aurait-il pas non plus quelques correspondances avec l’arabesque, courbe qui enfante sans cesse d’autres courbes ? Le goût des Arabes pour les formes effilées qui expriment le mouvement ne laisse-t-il pas concevoir que « le chanvre a fait les minarets », a inspiré les jardins aux jets d’eau filiformes et les arcs surhaussés ?
Les impressions hallucinatoires (que les usagers du haschich ne trouvent que s’ils veulent les rechercher) ne s’apparentent pas aux photos statiques : « L’œil, la bouche, ou telle ou telle partie du visage que je regarde, comme pris dans un impondérable presque psychique poudroiement, ou oscillation, ou balancement subtil, s’anime, ne bougeant pas vraiment, mais ayant pu bouger, ayant pu profiter d’un moment pour bouger. » Cette aspiration au mouvement s’exprime enfin par le rire : un rire vibratoire qui envahit, même sans cause. Ainsi, ce rire qui emporte Michaux devant la carte de l’Argentine : « Sans bouger, prodigieusement amusé, je savourais le comique exorbitant de la forme de ce pays qui, je l’avoue, m’avait jusque-là parfaitement échappé et qui le surlendemain à nouveau m’échappait complètement. »
Michaux et sa conception des états de la psyché
De ces rencontres avec les drogues, mais aussi des recherches qu’il mena auprès des « peintres aliénés » émerge, conformément à son projet de 1923, une représentation singulière de la psyché.
Michaux théorise trois états de la psyché. Le premier serait l’état « normal » qu’il définit comme un état où les pulsions se manifestent dans leur antagonisme, un état de « mélange » en raison des mouvements contradictoires des désirs. À l’état normal, nos pulsions se contrarient, nous rendent hésitants, réfléchis, etc. Parfois, leur antagonisme engendre des symptômes.
Il y aurait un second état que Michaux a exploré grâce aux drogues hallucinogènes – mais aussi grâce au rêve – (voir Façons d’éveillé, Façons d’endormi, 1969) – et en observant des psychotiques ou en étudiant leurs productions artistiques. Dans cet état de la psyché, les pulsions n’ont plus rien d’antagoniste, car elles se manifestent dans une « dualité fanatique ». Ainsi, la pensée « néoténique » du hachichin, où les pensées se succèdent, les unes chassant les autres. Breton, le rêveur, acquiesce successivement à l’idée que les petites filles sont des « hallucinatoires » puis, à l’idée qu’une hallucination peut être tangible ; puis, qu’elle peut être matérielle, si une hallucinatoire peut pisser et, enfin, qu’il est invraisemblable de penser de prétendre qu’une hallucination soit autre chose qu’une hallucination… Les idées contradictoires et les différentes motions pulsionnelles qui les animent se suivent et le rêveur acquiesce tout à tour à chacune d’elles. Dans ce second état, les pulsions se suivent dans un « absolu non-mélange ».
Il y aurait, enfin, un troisième état. Celui-ci sans alternance, comme « sans mélange », où la conscience se manifeste dans une totalité inouïe sans « antagonisme ». État proche de l’extase, où la conscience perçoit les pulsions qui l’animent, comme unies. Ces états d’extase peuvent être « extase cosmique » (tel le sujet kantien éprouvant le sentiment du « sublime », sentiment qui unit indistinctement le plaisir de contempler la grandeur et la contrariété d’éprouver ses propres limites). Ce peuvent être des « extases d’amour » (comme chez Stendhal où l’être aimé se donne comme une image qui « cristallise » les différents désirs qu’il inspire, désirs distincts qui forment autant de facettes du même objet) ; ou encore « extase érotique » (comme chez Bataille, ou le sujet érotisé unit, dans un sentiment d’immanence, l’animalité et le sentiment du sacré) ; ou encore « extase diabolique » (comme chez Sade, où le libertin unit la délicatesse à une cruauté sans bornes.) Sa théorie du psychisme rompt avec les conceptions « dynamiques » et « mécaniques » de l’appareil psychique de Freud (où les pulsions sont exprimées comme des forces exprimables par des quanta), pour affirmer une conception plus « physique » de la psyché avec des pulsions qui s’expriment par des « ondes » et par des états « mélangés », « non mélangés » ou fusionnés.
En guise de conclusion
Comment conclure cette enquête sur les poètes du XIXe et du XXe siècle qui firent usage du haschich. En affirmant que le haschich, s’il n’est évidemment pas un vecteur de créativité au sens où il susciterait un état « d’inspiration », fut pour le poète une sorte de défi. La littérature ne se comprend pas sans l’amour du langage et sans le désir de mettre en mots (cela étant ce que sont les couleurs pour le peintre) les expériences intérieures. L’essentiel ici est littéraire, c’est-à-dire effort pour donner à ressentir un état de conscience altéré par le haschich, avec des mots évoquant des images graphiques qui font ressentir de l’invisible, en l’occurrence, une intériorité. Travail qui n’a de sens qu’autant qu’il change notre conscience du monde.
Par-delà l’intérêt littéraire, je voudrais, dans un troisième article, montrer que ce détour par la littérature peut aussi nous aider à percevoir autrement l’usage que font les jeunes du XXIe du haschich qui semble être pour eux une drogue d’élection. ■