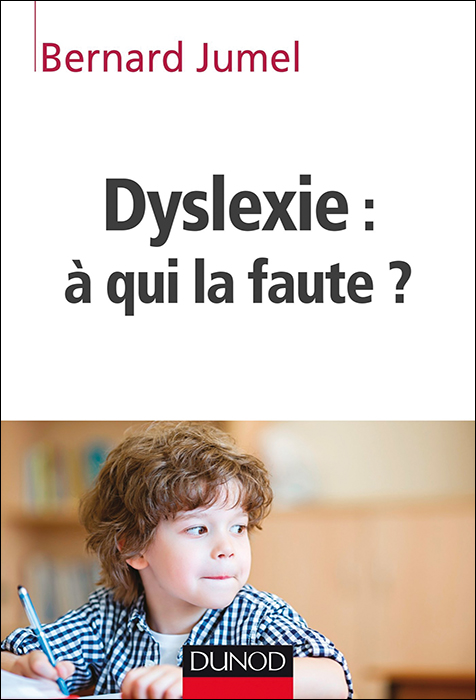Dossier : journal des psychologues n°251
Auteur(s) : Plaza Monique, Raynaud Sylvie
Présentation
Les enfants entrant au collège sans maîtriser la lecture dépassent les 20 %. Pourtant, la dyslexie est de plus en plus appréhendée comme une altération d’ordre génétique, alors que le trouble dont il est question porte avant tout sur un apprentissage culturel. Les profils des enfants dyslexiques sont extrêmement variés et révèlent l’impact de l’environnement, ce qui montre que le phénomène de la dyslexie est très complexe, et contredit la théorie selon laquelle il s’agit d’un désordre unitaire.
Mots Clés
Détail de l'article
En France, la dyslexie fut dans les années soixante-dix et quatre-vingt un objet de vives controverses, entre l’approche psychoaffective qui la concevait comme l’équivalent d’un trouble névrotique (Chiland, 1983), l’approche organiciste qui la définissait comme une maladie (Debray-Ritzen & Melekian, 1970), et l’approche socio-éducative qui la considérait comme résultant de défaillances socioculturelles et pédagogiques (Fijalkow, 1990). De ce fait, notre pays prit en compte avec retard cette difficulté, définie en Amérique du Nord et Europe du Nord, depuis plusieurs décennies, comme un trouble spécifique du langage écrit. Les enfants dyslexiques furent au mieux ignorés, au pis maltraités par notre système scolaire et nos structures de soin. Il fallut attendre le deuxième millénaire pour que fussent officiellement définis la dyslexie et un plan d’action encadrant sa prise en charge.
La dyslexie de développement
La dyslexie de développement donne lieu, depuis plusieurs années, à une pléthore de publications internationales (plus de cinq mille en dix ans dans la Banque de données PubMed). Une récente expertise de l’INSERM rend compte – non sans quelques regrettables lacunes – de certains travaux français sur le sujet. La dyslexie est devenue l’un des objets d’étude privilégiés des neurosciences – neurologie, neuropsychologie et génétique. Après avoir été définie comme un trouble spécifique du langage écrit affectant des enfants « normaux » (sans déficit intellectuel, langagier, sensoriel, neurologique, psychopathologique), la dyslexie est de plus en plus considérée comme une maladie neurologique d’origine génétique, apparaissant chez 5 à 10 % des enfants, quels que soient leur langue et leur pays. Une « maladie » au statut cependant spécifique, puisqu’elle est accessible à des traitements ou entraînements d’ordres essentiellement cognitif et langagier.
La lecture est une invention récente de l’humanité dont le développement a requis le recrutement d’aires cérébrales jusqu’alors consacrées à d’autres activités. Elle implique l’apprentissage explicite d’un code symbolique, la mise en jeu de compétences cognitives complexes (langage, perception, attention, capacités visuospatiales, sensorimotrices, mnésiques, intermodales) et la disponibilité psychique de l’enfant (maturité psychoaffective, motivation). Elle est inscrite dans le cadre scolaire et elle est assujettie à des programmes et des recommandations pédagogiques. Quels que soient l’origine et le statut qui lui sont attribués, elle constitue un trouble d’apprentissage.
La dyslexie de développement a été définie, ces vingt dernières années, en référence à des théories issues de la neuropsychologie des adultes cérébrolésés et de la psychologie de l’enfant. La conjonction de ces approches – dans laquelle la psychopathologie a tenu une place dont on dira par euphémisme qu’elle est modeste – a résulté en un modèle des stratégies de lecture (le fameux modèle à deux voies : 1. « assemblage » ou stratégie « alphabétique » et 2. « adressage » ou « voie orthographique ») et à une classification des troubles de la lecture, très proche de celle des dyslexies acquises. Cependant, de même qu’un cerveau encore immature n’est pas comparable à un cerveau adulte, un trouble acquis affectant des compétences déjà installées n’est pas comparable à un trouble affectant des compétences en développement. De ce fait, la théorie des deux voies de la lecture a été mise en cause chez l’enfant, dont la constitution du stock orthographique (l’adressage) dépend de l’automatisation de l’assemblage ou voie phonologique (maîtrise et respect de l’ordre séquentiel des correspondances graphèmes/phonèmes).
Dyslexie phonologique et dyslexie visuo-attentionnelle
La théorie phonologique est donc devenue prépondérante, tant dans les modèles du développement de la lecture que dans la classification des dyslexies de l’enfant. La classification a fait coexister la « dyslexie phonologique » (trouble spécifiquement langagier) et la « dyslexie visuo-attentionnelle » (trouble spécifiquement visuel), l’ancienne « dyslexie de surface » devenant un simple retard dans la constitution du stock orthographique. Les processus phonologiques diversement atteints concernent la conscience phonologique (sensibilité aux unités syllabiques qui apparaît avant l’apprentissage de la lecture, et capacité de manipulation des phonèmes qui se constitue après), la mémoire de travail auditivo-verbale (empan et boucle articulatoire) et l’accès en mémoire à long terme au code phonologique des mots. Cette théorie a semblé trouver une confirmation dans les travaux de neuro-imagerie fonctionnelle montrant que la région périsylvienne gauche, qui sous-tend les représentations phonologiques, serait différemment activée chez les dyslexiques et les normo-lecteurs (Shaywitz et al., 2002, 2003). Trois hypothèses étayent la théorie phonologique : (a) le trouble temporel de l’information auditive (Tallal et al., 1996), (b) le déficit des représentations auditives affectant la discrimination et la catégorisation des phonèmes (Dufor et al., 2007) et (c) le déficit de la représentation motrice de la parole (Liberman & Mattingly, 1985). Les programmes d’entraînement et de remédiation mis en place ont porté sur ces dimensions supposées défaillantes, avec plus ou moins de bonheur.
Cependant, comme certains dyslexiques n’ont pas de difficultés phonologiques et que la lecture est une activité non seulement linguistique mais également visuelle, la théorie visuelle s’est focalisée sur les processus visuels requis par la lecture : stabilité de la fixation binoculaire, position optimale du regard, stratégie de balayage, attention fine. Des difficultés oculomotrices et d’attention visuelle étant observées chez certains enfants dyslexiques (Boden & Giaschi, 2007), des protocoles de remédiation utilisant notamment des verres prismatiques leur ont été proposés, améliorant apparemment leurs performances (Quercia et al., 2007). L’hypothèse visuelle a été renforcée par des travaux psychophysiques et neuro-anatomiques montrant l’existence d’anomalies dans les voies magnocellulaires du noyau genouillé latéral, aboutissant à des déficiences dans les processus visuels et, via le cortex pariétal postérieur, à une anomalie du contrôle visuel.
Entre théorie phonologique et théorie visuelle, l’hypothèse du double déficit a tracé – non sans difficulté – son chemin. Voici plus de trente ans, Denckla et Rudel (1976) avaient observé que certains enfants dyslexiques étaient lents pour dénommer des séries de stimuli visuels simples, familiers, correspondant à des mots fréquents. Cette lenteur, présente avant l’apprentissage de la lecture, persiste à l’âge adulte : elle apparaît donc comme un marqueur de déviance. Contrairement à ce qu’ont longtemps clamé les tenants de l’hypothèse phonologique exclusive, les tâches de dénomination rapide ne sont pas purement phonologiques. Comme la lecture, elles requièrent la perception visuelle, l’attention, la mémoire de travail, l’anticipation, l’inhibition, la flexibilité, l’accès au code phonologique du mot, son articulation. Des analyses fines ont montré que la lenteur des enfants dyslexiques dans ces tâches relevait d’une difficulté dans le traitement de l’intervalle entre les stimuli, c’est-à-dire dans l’alternance entre activation et inhibition (Wolf & Obregón, 1992). Sur la base de cette hypothèse, on a différencié trois types de dyslexie : le premier se caractérise par un trouble exclusif des processus phonologiques, le second par un trouble exclusif de la dénomination rapide et un troisième (le plus grave) qui combine les deux troubles. Dans une étude récente, King et al. (2007) ont testé l’hypothèse du double déficit dans un groupe de 93 enfants dyslexiques, et ils ont trouvé que 79 % des participants entraient dans cette classification, les 21 % restants ne présentant aucun des deux troubles. L’hypothèse du double déficit dans la dyslexie a été confirmée par plusieurs éléments : (a) les analyses longitudinales montrant l’existence de troubles précoces de la dénomination chez certains adultes devenus dyslexiques ; (b) les analyses de régression hiérarchique multiple démontrant que phonologie et dénomination rapide sont des variables indépendantes l’une de l’autre ; (c) les travaux de neuro-imagerie révélant que les tâches de dénomination rapide – tout comme la lecture – activent un réseau complexe (frontal, temporal, occipital, pariétal, cérébelleux), ce qui n’est pas le cas des tâches phonologiques dont l’activation est plus localisée (Misra et al., 2004) ; (d) les études interlangues montrant que, dans les systèmes alphabétiques les plus transparents, la variable « dénomination rapide » a plus d’influence que la variable « phonologie ». Enfin, l’échec des programmes phonologiques appliqués à certains enfants dyslexiques a montré la limitation de l’hypothèse phonologique et la nécessité de prendre en compte d’autres variables, notamment le lexique et la fluence (Wolf & Bowers, 2000 ; Lovett et al., 2000).
Trois théories unitaires
La tentation des chercheurs est de concevoir la dyslexie comme un désordre unitaire, sous-tendu par la défaillance d’un seul module, en lien avec une anomalie génétique. Comme certaines dyslexies associent aux troubles du langage des défaillances visuelles, motrices, auditives, temporelles, tactiles, des chercheurs ont proposé les théories « magnocellulaire » et « cérébelleuse » pour intégrer ces troubles divers sous un label unitaire, non réductible à la seule phonologie (Livingstone et al., 1991 ; Galaburda et al., 1985 ; Rae et al., 1998 ; Nicolson et al., 1999 ; Brown et al., 2001). Ramus et al. (2003) ont évalué la validité des trois théories « unitaires » (cérébelleuse, magnocellulaire et phonologique) de la dyslexie dans une étude impliquant seize sujets. Ils ont conclu que seule la théorie phonologique était validée. Cependant, ces auteurs considèrent la dénomination rapide comme une compétence phonologique et ils restreignent la représentation motrice de la parole à l’articulation. De notre point de vue, aucune de ces trois théories n’a un pouvoir d’unification, même si la phonologie est largement requise par les contraintes du système alphabétique et le lien entre langage oral et écrit.
En fait, la notion de désordre unitaire ne correspond pas au constat de tous les cliniciens : les troubles dyslexiques sont divers. Si leurs manifestations en termes de déficits de lecture et d’orthographe sont comparables, les profils cognitifs, linguistiques et psychoaffectifs des enfants qui les présentent sont éminemment hétérogènes. Cette hétérogénéité confère une certaine imprécision, voire une discordance, à toutes les recherches qui sont menées sur des groupes d’enfants dyslexiques, dont les effets de moyenne occultent les différences inter et intra-individuelles. Au plan méthodologique, seules les études de cas uniques et les études longitudinales qui comparent les sujets à eux-mêmes présentent sur ce point une certaine rigueur. C’est grâce à elles que l’on a pu montrer le caractère multifactoriel du développement de la lecture, dont les prérequis ne sont pas seulement phonologiques, mais également sensoriels, moteurs et intermodaux (Korhonen, 1995 ; Plaza & Guitton, 1997 ; Plaza & Cohen, 2004, 2005, 2006).
La difficulté est de distinguer, dans la dyslexie, ce qui relève de l’amont et ce qui relève de l’aval. On sait que l’apprentissage de la lecture permet le développement ou l’optimisation de certaines compétences telles que la conscience phonémique, la position optimale du regard, l’attention, la mémoire, les répertoires lexical et syntaxique. Dès lors, la présence de « déficits » ou d’« anomalies » chez un enfant qui ne sait pas bien lire signifie-t-elle que l’on a trouvé la « cause » de la dyslexie ? Les études de neuro-imagerie ont mis en évidence des sites très variés de dysfonctionnement : le planum temporal gauche, le corps calleux, les cortex frontal, pariétal, occipital, le cervelet (Geschwind, 1974 ; Temple et al., 2001 ; Dufor et al., 2007). Cependant, lorsque l’on connaît la plasticité du cerveau, et son fonctionnement interconnecté, on peut aisément supposer que les stratégies qu’un enfant dyslexique utilise pour lire seront, par un principe d’isomorphisme ou plutôt de miroir, « lisibles » dans son cerveau… Et donc, qu’à mode de lecture atypique correspondra mode d’activation cérébrale atypique (Arns et al., 2007, Hoeft et al., 2006). Le cerveau, partie éminente du vivant, est lui-même soumis aux effets de l’environnement socio-économique et culturel (Shaywitz et al., 2003, Siok et al., 2004).
Le même principe de précaution épistémologique est à respecter face aux recherches génétiques : certes, il existe des familles à risque de dyslexie – les chromosomes 1, 3, 15, 18 ont été mis en cause (Paracchini et al., ; Grigorenko et al., 2001 ; Schumacher et al., 2007) –, mais nous ne pouvons définir aujourd’hui les liens entre phénotype et génotype, entre gènes et environnement. Même dans des maladies neurodégénératives, il a été montré que les facteurs environnementaux interviennent pour déclencher, révéler, amplifier ou réduire les effets de la maladie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le trouble dont il est question porte sur un apprentissage culturel, dont l’apparition est récente dans l’histoire de l’humanité.
Environnement culturel
Aujourd’hui, dans certaines classes de cycle primaire, 50 % des enfants sont en rééducation orthophonique. Le terme de dyslexie est galvaudé, à l’instar de ceux de dyspraxie, de précocité intellectuelle. Un mémoire récent d’orthophonie portant sur la qualité de l’orthographe montre un décalage significatif entre les tranches d’âge : les personnes de cinquante ans ont de meilleurs résultats que celles de vingt ans. Les compétences orthographiques ont considérablement chuté (rendant le diagnostic de « dysorthographie » de plus en plus aléatoire), et le nombre d’enfants entrant en 6e sans maîtriser la lecture dépasse les 20 %. On ne peut imaginer que le cerveau et les gènes des individus se soient détériorés en trente ans. En revanche, on doit mettre en cause l’environnement culturel, qui laisse moins de place à l’écrit, et la pédagogie de la lecture qui, de controverses en conflits, a de moins en moins respecté les contraintes qu’impose au cerveau d’un jeune enfant le système alphabétique. Un enfant – surtout lorsqu’il dispose de ressources limitées (attention, mémoire, langage…) – ne peut pas bien apprendre à lire si on ne lui a pas enseigné la clef du code de correspondance graphème/phonème et s’il n’en a pas intégré dans son corps (oreilles, yeux, mains, bouche) toutes les voies d’accès.
Or, cette intégration prend ses racines dans l’histoire et l’expérience précoce de l’enfant. Pour se développer, l’enfant a besoin d’interactions avec autrui. Deux théories nous apportent, de ce point de vue, un éclairage passionnant : la théorie motrice de la parole et celle des neurones miroirs. L’existence des neurones miroirs a d’abord été démontrée chez le singe, dont la même région motrice du cerveau s’active lorsqu’il casse une cacahuète, lorsqu’il observe un congénère casser une cacahuète ou lorsqu’il entend la brisure d’une cacahuète. Chez l’humain, le fait de réaliser une séquence motrice, de l’imaginer, ou de l’observer chez autrui, active les mêmes neurones miroirs (Fadiga et al., 2002 ; Rizzolatti & Craighero, 2004). La théorie motrice de la parole suppose que, pour apprendre à parler, l’enfant n’a pas seulement besoin d’écouter : il doit regarder le visage de l’autre et observer les mouvements qu’il fait (Kohler et al., 2002 ; Liberman et Mattingly, 1985). Dès l’âge de cinq mois, un bébé observant un visage qui articule des syllabes est sensible à la non-congruence entre la syllabe entendue « mi » et la syllabe prononcée /ta/. Grâce à cette capacité d’interaction et de traitement intermodal (visuel et verbal), l’enfant acquiert la représentation de l’incarnation de la parole. Ses « neurones miroirs » s’activent en écho à la parole de l’autre et, grâce à cette activation, il peut comprendre ce que l’autre lui dit et lui parler à son tour. Plus tard, lorsqu’il abordera la lecture, c’est cette parole incarnée qu’il va apprendre à déchiffrer dans les signes écrits. L’interaction précoce avec l’autre est donc une condition incontournable du développement. Pour comprendre la parole orale, puis écrite, notre cerveau la produit et la reproduit dans l’interaction avec l’autre, l’imitation de l’autre. De ce point de vue, la psychanalyse et la psychopathologie des interactions précoces peuvent apporter un éclairage pertinent, complémentaire à celui de la psychologie cognitive et des neurosciences.
Le système alphabétique segmente les syllabes (unités « naturelles » de la parole) en phonèmes et il utilise les lettres pour représenter les voyelles et les consonnes. La différence de saillance acoustique de ces unités (la consonne ne « s’entend » qu’en coarticulation avec une voyelle) suggère que le système alphabétique est fondé sur la représentation motrice de la parole. Le langage oral active formellement des représentations prosodiques, phonétiques et articulatoires associant oreille, œil et bouche. Le langage écrit – lecture et transcription – active formellement des représentations visuelles, verbales et graphiques associant œil, oreille, bouche et main (Raynaud et Plaza, 2006). Dans toutes les dyslexies de développement apparaissent des difficultés d’apprentissage des correspondances graphèmes/phonèmes, mais leurs fondements sont différents, précisément parce que le développement du langage écrit requiert la mise en jeu de multiples connexions intermodales. Cela nous explique pourquoi les profils des enfants dyslexiques sont si divers, et cela nous enjoint à admettre que toutes les hypothèses – phonologique, visuelle, intermodale, motrice… – ont une validité. Cela nous prouve également que, lorsque les modes de correspondance graphèmes/phonèmes ne sont pas enseignés dans le respect de cette complexité, les enfants – surtout s’ils ont des fragilités développementales – ne peuvent en abstraire les invariants et les transférer pour décoder et transcrire seuls tous les mots de leur langue.
Les recherches menées en neurosciences se sont focalisées sur les facteurs cognitifs, génétiques, biologiques, oubliant parfois que l’apprentissage de la lecture dépend de variables environnementales, psychologiques, pédagogiques. Comme chaque enfant dyslexique affronte les contraintes du système alphabétique avec ses propres ressources, la recherche sur la dyslexie doit intégrer de façon extrêmement étroite neurosciences et pédagogie, théorie et pratique, gènes/cerveau et environnement, contraintes internes et contraintes externes, clinique et expérimentation. C’est à cette seule condition qu’elle pourra impulser des programmes de remédiation adaptés aux profils cognitifs très diversifiés des enfants dyslexiques (Helland, 2007 ; Wanzek et al., 2006 ; Fawcett & Nicolson, 2007 ; Eden & Moats, 2002) et cesser de courir après la chimère de la pensée unique… pour se faire à l’idée qu’elle apporte un petit éclairage, nécessairement restreint, à un phénomène très complexe. ■